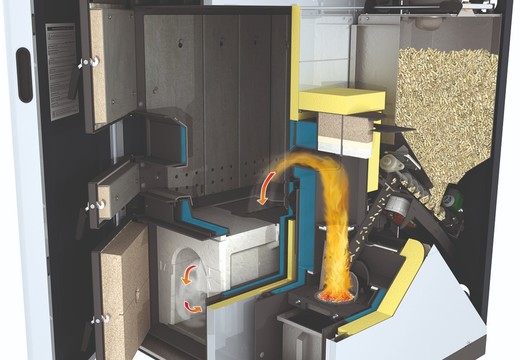Un arrêté, publié au Journal officiel du 27 juin, homologue une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qui modifie les conditions de prélèvement d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux de la centrale nucléaire du Blayais (Gironde). Désormais, la température en amont du réacteur n'est plus prise en compte dans le suivi de la centrale. Un mode de fonctionnement en situation climatique exceptionnelle est aussi prévu. Quant aux températures maximales de rejets des eaux de la centrale, elles restent inchangées, mais les modalités de mesure sont revues et les conditions applicables en été sont étendues.
En parallèle, l'ASN publie un premier bilan en trois points des dérogations accordées l'été dernier concernant les rejets thermiques des centrales nucléaires de Saint-Alban (Isère), Tricastin (Drôme), Bugey (Ain), Blayais et Golfech (Tarn-et-Garonne). « Pour la centrale du Blayais, les résultats de la surveillance physico-chimique, microbiologique et hydrobiologique n'ont pas mis en évidence d'effet notable du fonctionnement de la centrale nucléaire en période de canicule sur le milieu récepteur », résume la note technique (1) de l'ASN relative aux rejets thermiques des centrales concernées. Celle-ci est accompagnée du bilan écosystémique (2) réalisé par EDF et d'un rapport de l'énergéticien sur la surveillance des eaux de surface en situation exceptionnelle (3) (ces deux documents n'abordent pas la centrale du Blayais).
Les rejets en berge et dans les marais revus
Le texte supprime aussi l'encadrement de la température des rejets « en berge ». Ces rejets concernent les eaux de certains équipements, comme les systèmes de lavage des tambours filtrants à l'amont du système de refroidissement des réacteurs, les circuits de réfrigération ou encore les bâtiments administratifs. Jusqu'à maintenant, la centrale n'était pas autorisée à rejeter en berge de l'eau dont la température dépasse 30 °C. Et la température de ces rejets ne devait être supérieure de + 1 °C par rapport à la température des eaux du milieu récepteur. Seul est maintenu le critère concernant la concentration ajoutée en hydrocarbures totaux fixé à moins de 5 mg/l pour ces rejets.
Quant aux eaux pluviales rejetées dans les marais, elles ne doivent pas dépasser une concentration de 5 mg/l en hydrocarbures et de 100 mg/l de matières en suspension. Le précédent texte fixait trois critères supplémentaires : une demande chimique en oxygène (DCO) inférieure à 125 mg/l ; une concentration en azote Kjeldahl inférieure à 30 mg/l ; et moins de 5 mg/l de métaux lourds.
Pour que la centrale puisse fonctionner normalement, l'arrêté précédent, pris en 2003, imposait que la température des eaux de la Gironde ne dépasse pas 30 °C. Cette température devait être respectée sur une période de trois heures consécutives en amont de la centrale et en aval (à 50 m des ouvrages de rejet situés en milieu d'estuaire).
Si la température dépassait 30 °C dans l'estuaire, EDF devait réduire la puissance d'un ou de plusieurs réacteurs. « Cette réduction de puissance doit être significative pour abaisser, le plus rapidement possible, la température des eaux du milieu », prévoyait l'arrêté de 2003, précisant que « le retour à la puissance souhaitée ne peut être effectué qu'après constatation pendant au moins trois heures consécutives, sur les deux thermographes, d'une température du milieu inférieure à 30 °C ».
Le nouveau texte maintient cette limite de 30 °C sur trois heures consécutives. Mais la température ne sera mesurée qu'à une distance des ouvrages de rejet supérieure à 50 mètres, et ne le sera plus en amont de la centrale. Par ailleurs, dorénavant, en cas de « conditions climatiques exceptionnelles », et si RTE requiert le fonctionnement de la centrale pour assurer la sûreté ou l'équilibre du réseau, la température limite autorisée des eaux de l'estuaire de la Gironde est relevée à 31 °C.
Plus de liberté pour l'application des conditions estivales
S'agissant de la température maximale des eaux rejetées par la centrale dans l'estuaire de la Gironde, la valeur était fixée à 36,5 °C pour la période estivale et à 30 °C le reste de l'année. Ces deux valeurs sont maintenues dans le nouvel arrêté. Mais le nouveau texte modifie deux critères de mise en œuvre de ces limites.
Tout d'abord, jusqu'à maintenant, la température des rejets était contrôlée en permanence en aval des déversoirs. Le nouveau texte prévoit un calcul sur une période de trois heures consécutives, selon des modalités annexées à la décision de l'ASN. Seconde modification : la température de 36,5 °C s'appliquait sur une période de cinq mois allant du 15 mai au 15 octobre. Le nouvel arrêté maintient la période de cinq mois, mais laisse la possibilité à EDF de choisir ces cinq mois de rejets à haute température sur une période continue située entre le 16 avril et le 15 novembre. EDF devra indiquer à l'ASN les dates de début et de fin de cette période.
De même, le nouveau texte reprend la valeur limite de 11 °C fixée dans le précédent texte pour l'échauffement de l'eau entre son prélèvement et son rejet et lui applique la nouvelle méthode de calcul sur trois heures. Ce niveau d'échauffement s'applique aussi aux conditions climatiques exceptionnelles.
Rejets radioactifs et chimiques réduits
Enfin, le nouvel arrêté modifie aussi les valeurs limites des rejets gazeux et liquides. Certains rejets gazeux radioactifs sont abaissés. C'est le cas du plafond fixé pour les gaz rares [abaissé de 72 000 gigabecquerels par an (Gbq/an) à 48 000 Gbq/an], pour les isotopes de l'iode (la valeur passe de 1,6 à 1,2 Gbq/an) et pour les autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma (valeur fixée à 0,28 Gbq/an, contre 1,6 Gbq/an avant). Même chose pour les effluents liquides : la limite annuelle des rejets de carbone 14 est abaissée à 260 Gbq/an (contre 600 Gbq/an avant), celle des isotopes de l'iode est réduite à 0,4 Gbq/an (contre 0,6 Gbq/an), et celle des autres émetteurs bêta ou gamma est limitée à 36 Gbq/an (contre 60 Gbq/an).
L'évolution est similaire s'agissant des rejets chimiques. Par exemple, le flux annuel d'acide borique est limité à 25,6 tonnes (contre 42 tonnes avant) et le flux annuel en azote est abaissé à 7,8 tonnes (auparavant, la centrale pouvait rejeter 10 tonnes d'ammonium, et les nitrates et nitrites n'étaient pas pris en compte).