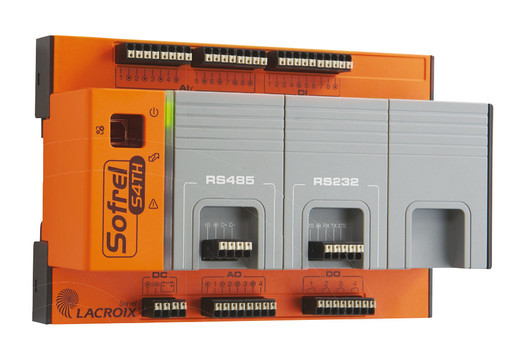Parmi les 538 mesures dérogatoires fiscales et sociales, représentant près de 104 milliards d'euros, que l'Inspection des finances a passé au crible dans son rapport (1) , penchons-nous sur les évaluations approfondies du crédit d'impôt développement durable et des dépenses fiscales liées à la consommation d'énergies fossiles.
Même si les deux dispositifs reçoivent une note sévère les classant dans la catégorie des mesures "non efficientes", le rapport fait malgré tout ressortir certaines contributions positives.
Un crédit d'impôt développement durable trop coûteux
Le crédit d'impôt dédié au développement durable (CIDD) et aux économies d'énergie a été créé en 2005 afin de renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l'habitation principale. "Cette mesure est désormais ciblée sur les équipements les plus performants au plan énergétique ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables", précise le rapport.
Ce dispositif a d'ores et déjà permis de réduire la consommation d'énergie primaire théorique du parc résidentiel de près de 8% et les émissions de GES théoriques de près de 7,5%, en 2010 par rapport à 2008. "Le CIDD a donc contribué à l'atteinte des objectifs environnementaux", conclut les rapporteurs.
L'objectif de réduction de 38% des consommations d'énergie du parc résidentiel d'ici 2020 ne sera toutefois pas atteint par les seuls outils que sont le CIDD et l'éco-PTZ, "mais ils y contribuent pour une grande part". D'autres dispositifs, comme les certificats d'économie d'énergie ou les réglementations thermiques, apporteront leur contribution.
Le problème est que ces progrès ne se font pas à moindre coût : 80 à 98 €/t CO2 évitée. Un chiffre à comparer aux 32 €/t proposés par Michel Rocard dans le cadre de la défunte taxe carbone. "Ce coût est certes en diminution, notamment avec les mesures prises dans les lois de finances 2010 et 2011, mais les effets d'aubaine semblent importants", souligne le document.
En ce qui concerne l'objectif "innovation" du dispositif, le CIDD a contribué à accroître la qualité énergétique des travaux demandés par les ménages, de même que les efforts d'innovation des entreprises. "Ces efforts ont été de deux natures", font ressortir les rapporteurs : technologique avec une "hausse de la performance énergétique des équipements proposés" et organisationnel avec la "mise en place de procédures de certifications et de démarches qualité, tant pour les équipements que pour la pose".
Quant à l'objectif "industriel" du dispositif, grâce à la mise en place du crédit d'impôt développement durable, la France est devenu l'un des premiers marchés européens pour certains équipements comme les pompes à chaleur ou les équipements et capteurs solaires thermiques.
"Le CIDD aurait permis d'accroître le chiffre d'affaires du secteur de près de 24 milliards sur la période 2008-2012, soit une moyenne annuelle de 4,8 milliards d'euros", détaille le rapport. En outre, ce dernier souligne que la plupart des filières aidées sont riches en emploi comparativement au reste de l'économie. "Le CIDD a donc vraisemblablement conduit à des créations d'emplois significatives dans ces filières, notamment sur la partie aval (distribution, installations et maintenance)".
Toutefois, "les technologies actuellement aidées par le CIDD semblent mâtures et les industriels français ne paraissent pas avoir d'avance technologique particulière sur leurs concurrents étrangers", tempèrent les rédacteurs du rapport.
Un impact environnemental négatif des mesures fiscales liées à la consommation d'énergie fossile
Le périmètre du rapport porte là sur 26 dispositifs fiscaux relatifs aux taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). La dépense est en fait concentrée sur cinq mesures principales : exonération de TICPE pour les carburants utilisés dans l'aviation commerciale (la plus coûteuse), fiscalité réduite du fioul utilisé comme carburant, remboursement partiel de TICPE aux transporteurs routiers, exonération de TICGN pour le chauffage des ménages et défiscalisation partielle des biocarburants.
"L'étude de ces mesures au regard des effets directs et indirects recherchés permet de conclure à des niveaux d'efficacité variable", conclut le rapport. Mais le bilan est globalement négatif.
D'abord, ces mesures ne jouent qu'un rôle secondaire dans la réorientation des comportements. "Hormis pour les dépenses relatives à l'aviation commerciale ou au transport maritime de passagers, la lisibilité de ces dépenses est donc faible pour le consommateur final", conclut le rapport. Ensuite, l'impact de ces mesures sur l'emploi est vraisemblablement non significatif, à l'exception peut-être de l'aérien et du BTP.
Sur le plan environnemental, enfin, l'impact des mesures est négatif. "Les dépenses fiscales accentuent l'insuffisante couverture par la fiscalité énergétique des externalités négatives liées à la consommation des énergies fossiles, l'absence de taxation ne favorisant pas les comportements économes en énergie", précisent les rédacteurs du rapport. Et même si l'impact négatif reste économiquement limité, cela "donne un signal-prix qui apparaît totalement contraire à l'objectif assigné à la fiscalité de l'énergie de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre", ajoutent-ils.
La fiscalité verte concernée par le coup de rabot fiscal ?
Des conclusions assez négatives donc, qui ne sont peut-être pas étrangères à la possible intégration de la fiscalité verte au coup de rabot fiscal envisagé par le Gouvernement.
"Je pense que s'il y a un coup de rabot général, les niches issues du Grenelle de l'environnement seront aussi concernées", a ainsi déclaré Nathalie Kosciusko-Morizet sur France Info le 30 août.