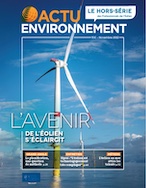Les débats tenus avant et durant la campagne de l'élection présidentielle de 2022 n'ont pas été tendres avec l'éolien. Plusieurs candidats ont même porté l'idée d'un moratoire sur la filière. Marine Le Pen, pour le Rassemblement national, a qualifié le bilan environnemental de la technologie d'« aberration écologique ». La réalité ne va évidemment pas dans ce sens.
Selon les travaux de l'Agence de la transition écologique (Ademe), le bilan carbone en analyse du cycle de vie d'une éolienne terrestre, en fonctionnement durant vingt ans, se situe en moyenne entre 12,7 et 14,1 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure produit (gCO2e/kWh). Côté maritime, le bilan carbone de l'éolien offshore posé, lui, se situe plutôt aux alentours de 14,8 à 15,6 gCO2e/kWh. Quant à l'éolien flottant, les premières données, présentées par la Commission nationale du débat public (CNDP), tendent davantage vers 42 gCO2e/kWh pour une éolienne pilote, avec une estimation de 19,5 à 22,5 gCO2e/kWh une fois la filière industrialisée.
L'essentiel des émissions comptabilisées provient de la fabrication et du transport, d'une part, et du démantèlement, d'autre part. Ce à quoi s'ajoutent les déplacements de maintenance en mer, pour la filière offshore. À titre de comparaison, c'est davantage que l'énergie nucléaire (6 gCO2e/kWh), mais moins que le photovoltaïque (43,9 gCO2e/kWh), le gaz naturel (243 gCO2e/kWh) ou le charbon (1 060 gCO2e/kWh). Malgré tout, l'éolien peut encore améliorer son bilan sur deux aspects : la fabrication et la fin de vie.
S'émanciper des terres rares
S'agissant de la fabrication, l'enjeu majeur demeure l'extraction des terres rares, ces métaux électromagnétiques qui composent les aimants permanents des éoliennes. L'impact de ce processus, qui demande l'utilisation de produits chimiques et d'une grande quantité d'eau, est loin d'être neutre pour l'environnement. Par ailleurs, l'approvisionnement de la filière en terres rares n'a rien de local : 90 % proviennent de Chine. Le bilan carbone de l'acheminement par bateaux de ces métaux jusqu'en Europe n'a, lui non plus, rien de neutre.
” Andrew Hine, GreenSpur Wind
Plus de bois, moins de béton ?
S'agissant justement du support, remplacer leur structure en ciment et en acier est également un moyen de réduire l'empreinte carbone des éoliennes. Innovent, une société française basée à Villeneuve-d'Ascq (Nord), mise sur une structure hybride s'appuyant sur une base en bois d'un peu moins de 50 mètres de haut (pour un mât de 150 mètres au total). Avec ce design, l'entreprise affirme avoir économisé 131 tonnes d'acier, soit un tiers du total habituel, et divisé par huit la quantité de béton utilisée pour les fondations. Cette économie lors de la fabrication assure à leur éolienne hybride de 2 MW une division par deux de son empreinte carbone : passant d'une émission de 816 tonnes d'équivalent CO2 à 359 tonnes. Cependant, à l'heure actuelle, ce modèle ne s'est pas encore démocratisé. Innovent n'a encore installé que trois de ses éoliennes hybrides, mises en service en mars 2021 au sein du parc d'Essey-les-Ponts (Haute-Marne).
Une nouvelle étape franchie dans le recyclage
L'autre point sur lequel l'éolien peut encore améliorer son bilan environnemental reste la fin de vie. La vague de « repowering » des parcs éoliens en fin de contrat (convenu sur quinze ans) soulève la question et, avec elle, celle du recyclage ou du réemploi des mâts démantelés. Pour assurer la circularité du processus, l'État a ainsi fixé des objectifs contraignants, par le biais de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). À compter du 1er janvier 2024, 95 % de la masse totale d'une éolienne, fondations incluses, devront être réutilisables ou recyclables.
Dans cette optique, l'Institut de recherche technologique Jules-Verne (IRT Jules-Verne) a lancé, en septembre 2020, le projet Zebra (pour « zero waste blade research »). Financé dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir (PIA), il se consacre au développement d'une pâle entièrement recyclable. Le 17 mars 2022, le consortium d'entreprises constitué autour de l'IRT Jules-Verne a annoncé la sortie de l'usine espagnole LM Wind Power d'un prototype à l'échelle, soit 62 mètres de long. Celui-ci a été fabriqué à partir d'une résine thermoplastique, remplaçant les matériaux thermodurcissables conventionnels. Cette matrice polymère a la propriété d'être dissociable de la fibre de verre et récupérable par dissolution, grâce à un solvant chimique spécial. Une fois industrialisé, un tel procédé éviterait l'enfouissement des pâles aux fibres de verre inséparables.
Cette perspective a par ailleurs attiré l'attention d'une société privée, Siemens Gamesa. L'entreprise germano-espagnole, dont une usine de pâles et de nacelles d'éoliennes en mer s'est installée dans le port du Havre, en mars 2022, est également parvenue à mettre au point une résine similaire. Six pâles en auraient même déjà bénéficié.