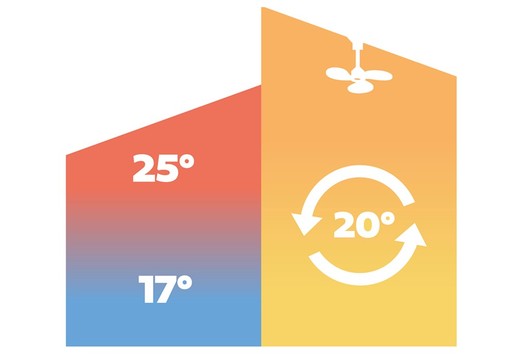Du 7 au 18 novembre se tiendra à Marrakech (Maroc) la 22e conférence des parties (COP 22) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc). Les négociateurs des 197 parties (1) à cette Convention ouvrent une nouvelle page des négociations climatiques internationales.
L'Accord de Paris adopté en décembre dernier est entré en vigueur le 4 novembre. L'événement est surtout symbolique, car il reste encore à décider les détails de sa mise en œuvre concrète, au plus tard d'ici 2020. La définition de ces règles recoupe certaines des grandes thématiques des négociations climatiques internationales : transparence, vérification des engagements, ou encore soutien financier aux pays en développement. Elles seront adoptées dans le cadre de la réunion des parties à l'Accord de Paris (CMA). Cet organe décisionnaire pour la mise en œuvre de l'Accord se réunira pour la première fois du 15 au 18 novembre. Auparavant, le Groupe de travail spécial de l'Accord de Paris (APA) préparera la CMA 1.
Qui peut participer à la CMA 1 ?
Actuellement, 96 Etats ont ratifié l'accord de Paris. Toutefois, les règles de participation à la réunion des parties sont telles que tous ces pays ne pourront pas prendre part à ce premier volet des négociations onusiennes.
Pour participer aux travaux de la CMA en tant que partie à l'Accord, un Etat doit avoir déposé sont outil de ratification au moins 30 jours avant la réunion qui débutera le 15 novembre. En d'autres termes, les seize Etats qui l'ont fait après le 16 octobre seront absents. Parmi ceux-ci figurent notamment l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, l'Indonésie et le Danemark
Plus subtile, des Etats qui ont déposé leur outil de ratification après le 16 octobre et avant le 19 octobre peuvent participer à la prise de décision lors du "dernier jour présumé" de la CMA 1, le vendredi 18 novembre. Aucun Etat n'est dans cette situation. En revanche, si la réunion devait déborder sur le samedi 19 novembre, l'Algérie et l'Uruguay pourraient prendre part à l'adoption des décisions.
A ce stade, de nombreux observateurs appellent les Etats à concrétiser les engagements adoptés l'an dernier à Paris. Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères marocain et président de la COP 22, a prévenu : "l'entrée en vigueur rapide de l'Accord (…) n'est pas une fin en soi mais seulement le prélude à sa mise en œuvre concrète". Il faut "transformer le texte et la vision de la COP 21 en réalité", résume le Réseau Action Climat (RAC). Toutefois, la présidence marocaine de la COP reste prudente. Elle présente la session de Marrakech comme un "trait d'union entre décision et action". Laurence Tubiana, négociatrice française, précise ce que pourrait être ce trait d'union : "L'enjeu le plus important à Marrakech, c'est de se mettre d'accord sur une date-butoir pour décider des règles d'application de l'accord, notamment les règles de transparence", explique à l'AFP celle qui fut la cheville ouvrière de l'Accord de Paris, précisant que "2017, ce n'est pas réaliste, mais 2018 c'est envisageable".
S'accorder sur des règles claires au plus vite est essentiel, notamment pour que les Etats puissent revoir à la hausse leur ambition avant 2025, voire 2030, échéance des contributions déposées avant la COP 21. Sur le plan climatique, le temps presse. "Le monde n'est (…) pas encore en voie d'atteindre l'objectif essentiel de l'Accord de Paris", rappellent dans un texte commun Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Ccnucc, et le président de la COP 22. Le 3 novembre, le Programme des Nations unis pour l'environnement (Pnue) a rappelé à quel point les engagements actuels étaient insuffisants pour respecter l'objectif fixé à Paris de limiter la hausse des températures "nettement en dessous de 2°C", voire à 1,5°C. Son rapport est sans appel (2) : avec les engagements actuels, le monde se dirige vers une hausse de 2,9 à 3,4°C. Il faut "de toute urgence prendre des mesures pour réduire de 25% les émissions prévues d'ici à 2030", alerte le Pnue. A cette date, elles devraient atteindre 54 à 56 milliards de tonnes (Gt), soit entre 12 et 14 Gt de trop. Il est donc indispensable de renforcer ces engagements avant 2020, selon le Pnue. Pour le RAC, il faudrait les revoir dès 2018.
S'accorder pour plafonner les émissions mondiales
La CMA devrait entrer dans le vif du sujet dès sa première réunion. Son agenda provisoire prévoit d'aborder la plupart des points cruciaux de l'Accord. Il s'agit en particulier de la mise en œuvre de l'article 4 qui est au cœur des questions soulevées par le Pnue : il vise un "plafonnement mondial des émissions de GES dans les meilleurs délais" pour "parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de GES au cours de la deuxième moitié du siècle". En clair : comment réduire les émissions de CO2 pour qu'à partir de 2050 elles n'excèdent plus les capacités d'absorption planétaires ? Ce même article aborde aussi les engagements nationaux, leur différenciation en fonction du niveau de développement des pays, le renforcement progressif des objectifs d'atténuation des Etats et le soutien apporté aux pays en développement. Sur ce dernier point, un récent rapport de l'OCDE indique que les 100 milliards annuels promis en 2009 à Copenhague (Danemark) ne sont toujours pas au rendez-vous.
La collaboration entre Etats sera aussi évoquée. Il s'agit en particulier d'aborder le maintien des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto (3) à l'origine des premiers marchés internationaux d'échange de crédit carbone. L'Accord de Paris prévoit qu'un Etat puisse bénéficier des réductions d'émissions réalisées dans un autre Etat. Mais les règles encadrant ce mécanisme sont délicates à mettre en œuvre, notamment parce que les engagements nationaux restent volontaires. De même, les négociateurs aborderont la mise en œuvre des articles 7 et 8 qui traitent respectivement de l'adaptation aux impacts des changements climatiques et aux pertes et dommages associés.