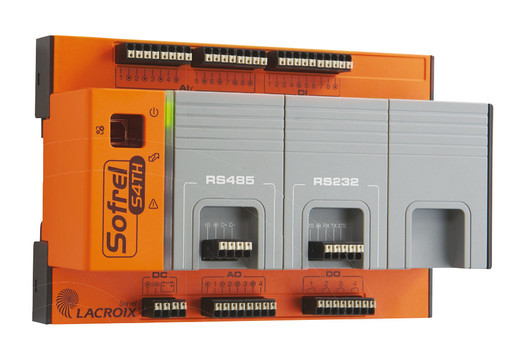La loi mentionne que cette modulation doit se faire en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage des bâtiments, mais aussi en vue d'encourager la diminution des émissions de gaz à effet de serre générées par l'énergie utilisée.
L'OPCEST était chargé de proposer ''un niveau pertinent de modulation'' pour la future RT 2012. Les députés Christian Bataille et Claude Birraux ont présenté leur rapport jeudi 3 décembre. Les groupes de travail chargés de définir la future réglementation devraient rendre leurs conclusions courant 2010.
Le principe des cinq usages réaffirmé et la production d'électricité exclue
Les députés Bataille et Birraux ont tout d'abord souhaité réaffirmer le principe de calcul sur cinq usages minimum de la consommation d'énergie dans le bâtiment. ''C'est une tendance lourde de l'évolution de la réglementation de prendre en compte un nombre croissant d'usages : en 1988, elle ne prenait en compte que le chauffage, l'eau chaude et les auxiliaires ; en 2000, elle a intégré l'éclairage ; en 2005, la climatisation''. Les rapporteurs soulignent d'ailleurs que la réglementation devra progressivement prendre en compte d'autres usages, comme les appareils électroniques, comme l'applique déjà le label allemand Passivhauss.
Les députés excluent la production d'électricité domestique d'origine renouvelable dans le calcul de la consommation énergétique. Selon eux, ''tout cela n'a que peu de chose à voir avec la performance thermique du bâtiment qui sert de support aux panneaux photovoltaïques. (…) De ce point de vue, les seules énergies renouvelables qui comptent sont celles qui contribuent à la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire''.
Localisation, taille et confort d'été
Quant à la modulation en fonction de la localisation, les rapporteurs préconisent de reprendre les coefficients de correction définis par le label Effinergie, qui se base sur les trois zones climatiques définies par la réglementation (de la zone H1, départements les plus froids à la zone H3, départements du sud méditerranéen) corrigées par trois coefficients prenant en compte l'altitude. Les députés Bataille et Birraux soulignent que quelques ajustements seront nécessaires, comme redécouper ''à la marge les zones climatiques du Nord-Est de la France en créant une zone limitrophe sur le Rhin à 70 kWh''.
Outre la prise en compte des différences climatiques relatives à l'hiver et aux besoins de chauffage, ''la nouvelle réglementation thermique doit également prévoir l'existence obligatoire de l'un ou l'autre systèmes de climatisation active, dans tous les bâtiments effectivement occupés au cœur de l'été'', note le rapport. Le branchement de l'aération sur un puits canadien, le recours à une pompe à chaleur fonctionnant aussi en réfrigérateur ou la mise en route d'un équipement spécifique de climatisation doivent être considérés dans les calculs selon les députés.
La taille du logement doit également être un critère de calcul : ''nos auditions ont permis de constater un consensus sur les difficultés particulières qu'auront les logements de petite surface à respecter une réglementation thermique plus contraignante. (…) L'idée de définir une valeur pivot, centrée sur la surface moyenne des logements, autour de laquelle une correction symétrique serait opérée selon une pente raisonnable, paraît judicieuse''. Un principe déjà mis en œuvre par la réglementation thermique allemande.
Pas de seuil pour le tertiaire mais un plafond
Pour le tertiaire, alors que le Grenelle prévoit que le seuil de 50 kWh/m²/an soit obligatoire à compter de fin 2010, les députés proposent de ne pas fixer de plafond de consommation, mais plutôt des normes d'isolation et d'imperméabilité, complétées par une recherche de performance effective. Ils soulignent la nécessité de prendre en compte dans les calculs la destination du bâtiment, c'est-à-dire l'activité qu'il héberge et pour lequel il a été spécialement adapté.
Le dispositif devrait être accompagné d'un système de mesure performant et de l'obligation de doter chaque bâtiment tertiaire d'un responsable énergie. Enfin, selon le rapport, chaque bâtiment devra faire publicité de ses performances sur place et sur un site Internet officiel.
Le coefficient de conversion de l'électricité conservé
Les députés étaient également chargés d'examiner les questions relatives au coefficient de conversion d'énergie finale en énergie primaire, qui rend compte de la quantité d'énergie primaire utilisée pour produire un kilowatt heure d'électricité consommée. Ce coefficient ''joue un rôle crucial dans les choix d'équipements pour les bâtiments dès lors que la norme thermique, évaluée en énergie primaire, n'est plus différenciée en fonction des filières, comme c'était le cas jusqu'à ce que l'article 4 de la loi du 3 août 2009 en décide autrement'', précisent les rapporteurs.
Aujourd'hui, la réglementation retient pour l'électricité un coefficient de 2,58 tandis que les énergies consommées directement sur place, principalement dans des chaudières ou des chauffe-eau, bénéficient d'un coefficient de conversion égal à 1.
Selon les rapporteurs, l'utilisation d'un chauffe-eau électrique par un foyer de 4 personnes suffit à dépasser le seuil de 50 kWh/m2/an. Une réalité qui devrait permettre de limiter le développement des modes de chauffage par effet Joule, qui équipent aujourd'hui près des deux tiers des logements neufs.
Christian Bataille et Claude Birraux jugent ce coefficient arbitraire et imparfait mais n'ont pas souhaité le modifier alors qu'EDF demandait qu'il soit temporairement ramené à 1 pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire par l'électricité et que l'association Négawatt, au contraire, demandait qu'il soit augmenté.