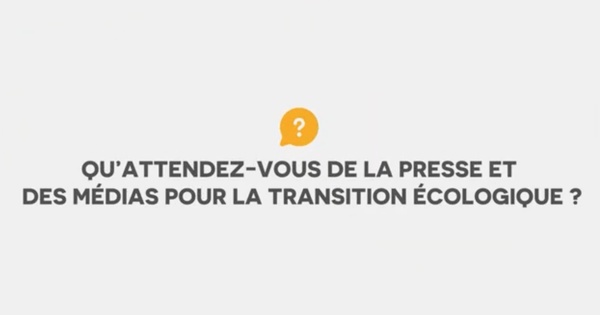Alors qu'en amont de la prochaine loi de programmation énergie-climat (LPEC), le Gouvernement planche actuellement sur son troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (Pnacc3), France Stratégie, son principal organe de réflexion, plaide pour la formulation d'une « stratégie nationale » d'adaptation du travail à la réalité climatique. « Les dispositifs réglementaires en vigueur (et les différents plans nationaux) restent insuffisants car ils s'inscrivent dans une logique de gestion d'événements exceptionnels, au détriment d'une approche plus structurelle et systémique », souligne une récente note d'analyse (1) du bureau stratégique de la Première ministre.
Jusqu'à 36 % des travailleurs « incommodés »
La nature de ce constat provient autant de la désorganisation des politiques publiques à ce sujet que de l'exposition d'un nombre croissant de travailleurs français au réchauffement climatique. À l'heure actuelle, d'après les chiffres d'une première enquête réalisée durant l'été 2017 par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, 1,5 million de salariés français travaillant « au chaud » (c'est-à-dire, en intérieur, mais avec une activité génératrice d'une température d'au moins 24 °C) et 3,6 millions travaillant en extérieur attestaient déjà souffrir de la chaleur estivale. Le sondage « Conditions de travail », mené lui aussi par la Dares en 2019, a recensé 9,7 millions de personnes affirmant être « incommodées » par la chaleur dans leur travail – une hausse de 10 % par rapport à un sondage similaire de 2013. En somme, jusqu'à 36 % de l'emploi total en France métropolitaine (ou 49 % en Outre-mer) souffre de la chaleur.
L'effet économique de la chaleur
Les familles de métiers les plus exposées à la chaleur
En examinant les résultats de l'enquête menée par la Dares en 2019, France Stratégie a identifié les familles de métiers les plus « incommodées » par la chaleur dans leur activité : près de 90 % des ouvriers qualifiés des travaux publics en témoignent, 85 % des maraîchers/jardiniers/viticulteurs et des ouvriers qualifiés du gros œuvre, ainsi que 75 % des agriculteurs/éleveurs/sylviculteurs/bûcherons et des ouvriers peu qualifiés du BTP. À l'inverse, seulement 5 % des assistants maternels, 6 % des professionnels du droit et environ 12 % des secrétaires, comptables ou cadres de la banque et des assurances avouent souffrir de la chaleur durant leur travail.
Au total, selon une étude américaine (3) publiée en janvier 2022, les conséquences de l'exposition à la chaleur sur la productivité mondiale représenteraient l'équivalent de 650 milliards d'heures de travail perdues par an. Sur le plan économique, « les vagues de chaleur survenues au cours des années anormalement chaudes (2003, 2010, 2015, 2018) auraient ainsi entraîné une baisse allant de 0,3 à 0,5 % du produit intérieur brut (PIB) européen, soit 1,5 à 2,5 fois plus que pendant une année moyenne », rapporte également France Stratégie. Et en suivant les dernières projections climatiques, ce phénomène devrait entraîner une baisse d'environ 1,5 % du PIB national après 2050.
Le besoin d'un « pilotage interministériel »
Le hic, soulève France Stratégie, c'est que le code du travail, par exemple, ne fixe aucune température maximale autorisant l'arrêt de travail contre les vagues de chaleur et ne donne aucune définition fixe de la canicule. « D'après diverses auditions menées auprès de fédérations professionnelles, les dispositifs mis en œuvre par les employeurs en cas de fortes chaleurs sont principalement conçus comme des mesures "d'attente" qui ne permettent pas une adaptation structurelle de l'organisation et des modes de travail. » En parallèle, les différents plans nationaux portés par plusieurs ministères, comme le Plan santé au travail (PST) ou le Plan national santé-environnement (PNSE), apparaissent « insuffisamment coordonnés et articulés », juge l'institution stratégique.
En réaction, cette dernière plaide pour la construction d'un « pilotage et d'une gouvernance à l'échelle interministérielle afin d'assurer une plus grande cohérence entre les plans et ce, de leur conception à leur déploiement à toutes les échelles », voire d'en formuler une approche globale sous la forme d'une stratégie nationale. Et France Stratégie d'ajouter : « la question de l'adaptation du travail au changement climatique doit intégrer dans les mesures préconisées la sobriété énergétique imposée par le contexte international, ce qui nécessite aussi de penser des solutions techniques qui ne vont pas à l'encontre de cet objectif – comme les climatisations énergivores ».