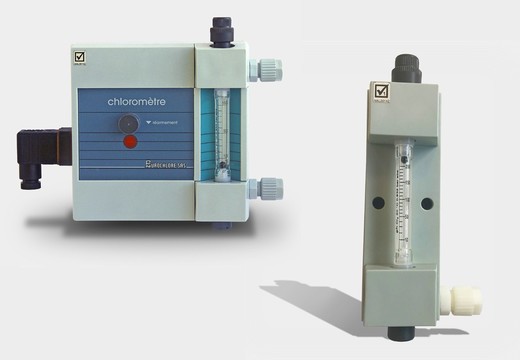Pesticides, métaux lourds, hydrocarbures, phtalates, composés organiques volatils et phénoliques… Ces micropolluants, utilisés dans de multiples processus industriels et entrant dans la composition de nombreux produits, se retrouvent à différentes concentrations dans les milieux aquatiques continentaux. Afin de disposer d'un état des lieux précis de la situation, le Service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable a publié un bilan de la présence de ces micropolluants entre 2007 et 2009. Au total, près de 950 substances ont été recherchées dans les rivières, plans d'eau, eaux souterraines ainsi que dans les sédiments des eaux superficielles de la France métropolitaine. Inscrit dans le Plan national micropolluants 2010-2013, ce bilan devrait favoriser la valorisation des données de surveillance acquises et surtout aider à la définition de nouvelles actions, nécessaires pour réduire l'impact de ces substances. La Directive cadre sur l'eau imposant aux Etats membres le bon état des eaux d'ici 2015 et la réduction des polluants prioritaires à l'horizon 2021.
Les micropolluants, majoritairement des pesticides.
En France, 92 % des points de mesure en cours d'eau et 70 % des points de suivi des eaux souterraines présentent au moins un pesticide quantifié entre 2007 et 2009. Mais, ces chiffres varient en fonction des bassins hydrographiques étudiés ainsi que de leurs activités agricoles. Ainsi, le Nord de l'Hexagone, le sud-ouest et le couloir rhodanien sont les secteurs les plus touchés par ces pollutions.
Une méthodologie totalement remise en question
Vendredi 14 octobre, le jour de la publication du bilan du CGDD, WWF rendait public une enquête sur le dispositif-français-d'analyse-de-la-qualité-des-eaux-souterraines-et-de-surface. Dans cette étude, WWF juge que la pollution de ces milieux aquatiques serait en fait sous-estimée. Le nombre insuffisant de substances toxiques recherchées, la faiblesse des protocoles de mesure, la non prise en compte de l'effet cocktail ainsi que des méthodes d'évaluation impropres à décrire l'état réel des eaux seraient les principales causes de la surveillance biaisée de ces écosystèmes.
Ces pesticides interdits ainsi que leurs métabolites présentent, en outre, une fréquence bien plus importante dans les eaux souterraines. Entre 2007 et 2009, sur les 15 pesticides les plus quantifiés dans ce milieu, 11 correspondent à des substances totalement interdites d'usage à cette période. "Ceci s'explique par des temps de migration des molécules vers les eaux souterraines plus importants que vers les cours d'eau, les pesticides pouvant être retenus dans les sols de la zone non saturée, souvent pendant plusieurs années. Les pesticides piégés dans les sols peuvent se dégrader en leurs métabolites qui vont ensuite être entraînés lentement vers les nappes, à l'occasion de pluie", détaille le CGDD dans son bilan.
En ce qui concerne le respect des normes, 11 % des points de suivi des cours d'eau et moins de 1 % des plans d'eau affichent des valeurs supérieures au seuil fixé par la réglementation. Même si les eaux souterraines présentent des concentrations en pesticides moins importantes que le autres milieux aquatiques continentaux, 27 % de ces points de mesure sont non conformes en raison de normes de qualité plus strictes.
HAP comme principaux responsables
Pendant ces trois années d'analyse, la présence de près de 400 micropolluants, autres que les pesticides, a également été étudiée par le CGDD. Générés lors de différentes combustions (déchets, charbon, bois, carburant…), les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont très largement retrouvés dans les cours d'eau métropolitains, auxquels s'ajoutent dans les sédiments les retardateurs de flamme de type Polybromodiphényl Ethers (PBDE) et les Polychlorobiphényles (PCB). "Les plans d'eau sont, quant à eux, caractérisés par la présence prédominante des dioxines et furanes. Avec des quantifications près de 10 fois inférieures à celles des eaux superficielles, les eaux souterraines se démarquent également par une présence significative de solvants chlorés. (…) Ceux-ci, très volatils, s'évaporent des eaux superficielles alors qu'ils ont tendance à s'accumuler dans les nappes", explique le CGDD.
Par ailleurs, la présence de métaux et métalloïdes dans les cours d'eau et les eaux souterraines est avérée, mais serait avant tout due à une origine naturelle.
Au niveau réglementaire, les HAP et les PBDE sont responsables de la quasi-totalité des dépassements de normes, bien loin devant toutes les autres classes de micropolluants (métaux, COHV, composés phénoliques). Ainsi, 40 % des points de mesure en cours d'eau et 7 % en plan d'eau ne respectent pas les normes de qualité au moins une année de 2007 à 2009.
Pour les eaux souterraines, près de 93 % des points de métropole sont conformes aux normes et seuils définis par l'arrêté du 17 décembre 2008. Les concentrations en HAP, accompagnées par celles en CHOV, seraient la cause principale de la non conformité de 7 % des points d'eaux souterraines. "Certains métaux et métalloïdes, tels que l'arsenic, le sélénium et le nickel sont également à l'origine d'un nombre important de dépassements. Toutefois, seul un examen au cas par cas permettrait de savoir si ces dépassements sont d'origine naturelle ou humaine", tempère le CGDD.
Enfin, les polluants dits émergents comme les résidus de médicaments ou les perturbateurs endocriniens n'ont pas été traités dans ce bilan car il n'existe pour l'instant pas de suivi régulier. Pour mieux caractériser la présence de ces substances dans les milieux aquatiques, des campagnes de recherche seront mises en place dans les eaux souterraines en 2011 et dans les eaux superficielles en 2012.