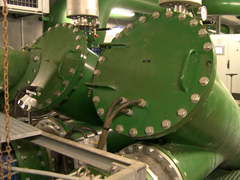3e vice-présidente de la région Occitanie, en charge de la Transition écologique et énergétique
Actu-Environnement : La région Occitanie a l'ambition de devenir le première région à énergie positive. Comment avez-vous élaboré la stratégie pour y parvenir ?
Agnès Langevine : Nous avons procédé en plusieurs temps. D'abord, nous avons voulu affirmer notre ambition : celle de placer l'Occitanie sur une trajectoire de région à énergie positive.
L'objectif est de s'inscrire dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la loi sur la transition énergétique. Pour y parvenir, nous avons décidé d'élaborer notre propre scénario, un peu sur le modèle du scénario produit par Négawatt, en s'appuyant sur deux piliers : l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce scénario a été élaboré avec des données et indicateurs de la région. C'est une première à cette échelle. Nous avons réuni plus de cent experts (élus, entreprises, associations, énergéticiens…) afin de travailler par vecteurs énergétiques et parsecteurs (bâtiment, transports, industrie, agriculture…) et élaborer des hypothèses à l'horizon 2050.
AE : Concrètement, qu'entendez-vous par région positive ?
AL : Nous nous appuyons sur un coefficient Repos (régions à énergie positive) qui mesure, en pourcentage, la part de la consommation d'énergie d'origine renouvelable produite en Occitanie sur la demande finale totale. L'objectif est de vérifier, pour tous les usages, que la consommation en 2050 pourra être assurée par des ressources renouvelables. En 2015, ce coefficient est de 19,4%. Dans un scénario tendanciel, il atteindrait seulement 34% en 2050. Notre objectif est d'arriver à 100%. Le travail de scénarisation effectué par les experts nous permet, nous élu-e-s, de prendre la mesure de la marche à gravir et des efforts à accomplir. Cette feuille de route nous permettra de calibrer nos dispositifs d'intervention pour répondre à la stratégie délibérée par l'Assemblée régionale en juin dernier.Le scénario Repos en bref
D'ici 2050, l'Occitanie veut réduire d'un quart la consommation énergétique du secteur résidentiel, malgré un accroissement de la population.
Dans le tertiaire, la demande devra baisser de 28%, en supprimant ou en minimisant notamment les besoins en climatisation alors que la région s'oriente vers des épisodes caniculaires plus fréquents. L'industrie et l'agriculture devront également fournir des efforts importants. La région prévoit une baisse significative de 46,9 TWh à 18,4 TWh des besoins énergétiques dans les transports. Cela passe par le télétravail, les transports doux, les véhicules électriques ou GNV…
Côté production, la région mise sur 200 MW d'éolien terrestre supplémentaires par an, une multiplication par 12 de la puissance installée en photovoltaïque d'ici 2050 et 3 GW d'éolien offshore au même horizon. La chaleur et le gaz ne sont pas oubliés, notamment le stockage par hydrogène.
AE : Quelles sont les prochaines étapes ?
AL : Dès octobre, nous allons présenter le scénario aux citoyens, acteurs et élus afin qu'ils se l'approprient. Cette étape est indispensable à l'accélération de la transition. Les acteurs doivent s'inscrire dans une démarche volontariste de changement tout en saisissant cette formidable opportunité pour la conversion des territoires. C'est un véritable défi : embarquer l'ensemble des territoires dans une dynamique commune. Nous allons mettre en lumière les solutions qui existent et accompagner les acteurs.
AE : Justement, avez-vous décliné les objectifs par territoire ?
AL : Nous n'avons pas souhaité territorialiser ce scénario. Il est très important de faciliter l'acceptation et, pour cela, nous ne pouvions pas décider de l'implantation d'un parc éolien là, d'une unité de méthanisation ici… Le projet de transition est avant tout une question d'appropriation. Ce serait contreproductif de planifier à une échelle trop fine. Il faut que la dynamique vienne des acteurs ancrés dans les territoires. Nous avons la chance d'avoir des gisements importants en éolien, solaire, biomasse et deux projets d'envergure de fermes éoliennes flottantes. Beaucoup de collectivités sont déjà engagées dans des démarches Tepos et nous pouvons nous appuyer sur de nombreuses entreprises dynamiques, le pôles de compétitivité Derbi… Nous souhaitons accompagner ces acteurs, pour améliorer notamment le dialogue environnemental et la séquence Eviter Réduire Compenser.
AE : La région va créer une agence régionale de l'énergie et du climat. Quel sera son rôle ?
AL : La nouvelle agence sera fonctionnelle début 2018. Ce sera l'opérateur unique pour la réalisation de nos objectifs. L'agence mobilisera des moyens d'ingénierie et de financements pour accompagner et accélérer les projets de rénovation ou d'ENR.
Elle proposera par exemple la réalisation d'études de faisabilité, des solutions de financements, des prises de participation au capital pour accompagner les innovations…
Nous envisageons également le déploiement du tiers financement, autrement dit des prêts à très long terme, pour accompagner les ménages qui n'ont pas accès aux prêts bancaires dans la réalisation de travaux.
Notre région affiche un taux de 12% de précaires énergétiques. Une bonne rénovation coûte en moyenne 27.000 €, ce qui n'est pas à la portée de tous. Notre objectif est d'accélérer et de massifier les rénovations. Le scénario prévoit un rythme de 52.000 rénovations par an d'ici 2030, puis de 75.000 au-delà. C'est très ambitieux, mais l'Occitanie est une région très attractive, qui va connaître une hausse démographique et donc une augmentation de la demande d'énergie.
AE : Quels seront les moyens consacrés à cette stratégie et comment allez-vous mesurer sa mise en œuvre ?
AL : Le budget est en cours d'élaboration. Nous prévoyons une montée en charge progressive. Nous avons déjà envoyé un signal politique porteur, les acteurs ont repéré notre ambition. Mais il ne faut pas que cela reste un slogan politique. Un comité de suivi a été créé pour analyser les avancées de la mise en œuvre de la stratégie et la réactualiser si besoin. Ce scénario est un premier jet, il n'est pas immuable. Une étude des impacts socio-économiques du scénario est en cours de réalisation. Elle va permettre de connaître les impacts sur l'emploi, les besoins en formation… Enfin, il y a une demande forte pour l'instauration d'indicateurs autres que le PIB ou le nombre d'emplois. Nous sommes en cours de réflexion autour d'outils mesurant la qualité de vie, l'implication citoyenne, la résorption de la précarité énergétique…