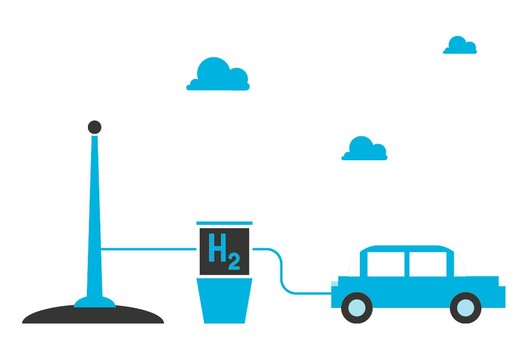L'influence de l'éolien en mer en termes de biodiversité, mais aussi de séquestration de carbone, a été quantifiée. En juin dernier, des chercheurs belges et néerlandais ont publié deux études complémentaires à ce sujet dans la revue Frontiers in Marine Science. Ces travaux s'appuient sur treize ans de suivi de l'écosystème marin de la première zone belge d'éolien offshore, inaugurée en mer du nord avec l'installation, dès 2008, du parc C-Power.
Pour rappel, l'installation d'éoliennes posées en mer est responsable d'un effet « récif » : une grande quantité de petits crustacés, de mollusques (comme les moules) ou de cnidaires (des anémones de mer, notamment) filtreurs, se greffent à leur pied, formant de véritables colonies. Ces dernières attirent ensuite d'autres espèces, principalement des poissons comme le cabillaud ou la plie. Cette biomasse entraîne une importante part de dépôt organique (cadavres et fèces, entre autres) sur le fond marin. En comparaison de zones alentours, la quantité de dépôt est évaluée jusqu'à 15 % de plus à l'échelle d'un parc éolien offshore, selon les résultats de la première étude (1) .
Cette matière organique – qui peut, elle-même, servir de nourriture à d'autres organismes – constitue une forme de stockage de carbone, laquelle a été quantifiée dans la seconde étude (2) . « Entre 28 715 et 48 406 tonnes de carbone sont stockées dans les 10 centimètres supérieurs du fond marin dans un parc éolien offshore pendant sa durée de vie, définie ici comme étant de vingt ans, explique Emil de Borger, chercheur à l'Institut royal néerlandais de recherche sur la mer (Nioz), dans un communiqué. Ce carbone est parfois appelé "carbone bleu", c'est-à-dire du carbone piégé dans des formes organiques (comme des animaux ou des plantes), qui est ensuite enfoui. Sachant que ces chiffres correspondent à 0,014-0,025% des émissions annuelles de gaz à effet de serre en Belgique, on peut considérer qu'il s'agit d'une compensation carbone modeste, mais néanmoins significative. »
Les chercheurs soulignent néanmoins que cette séquestration n'est pas garantie sur la durée. Le chalutage de fond ou le démantèlement des structures en fin de vie peuvent en effet conduire à la libération de ce carbone. Pour l'éviter, les scientifiques préconisent, par exemple, un « démantèlement partiel, dans lequel une partie de la structure sous-marine reste en place, est réaffectée ou déplacée ».