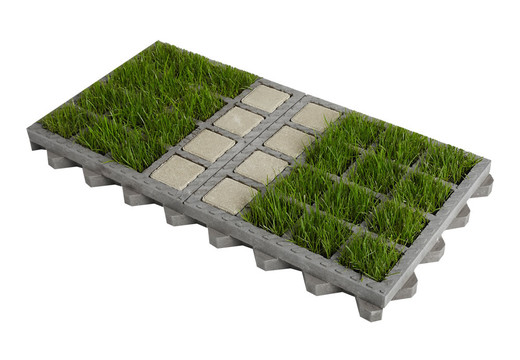À l'heure où les agriculteurs doivent faire face à une baisse de leurs revenus et que l'opposition compétitivité/environnement domine l'actualité, Joseph Ménard, responsable biodiversité à la Chambre nationale d'agriculture affirme qu'il ''n'y a pas d'incompatibilité !''. D'après lui, certains agriculteurs accompagnés ''n'ont pas non plus attendus le Grenelle'' pour entreprendre ces démarches volontaires pour limiter l'impact environnemental de leur activité. Dans la région, 500 km de bandes enherbées et de recoupement ont d'ores et déjà été amorcés permettant notamment de renforcer les corridors écologiques (trames vertes et bleues prévues d'ici fin 2012).
Haies et bandes enherbées, refuges d'insectes auxiliaires

La jachère ''faune sauvage''
Une autre initiative vise cette fois à conjuguer pratiques agricoles raisonnées et cynégétiques en grande culture à Bayonvillers (Somme). Outre 600 m de haies implantés dans son exploitation betteravière et patatière de 90 ha, l'agriculteur et chasseur Jean-François Dessaint a également dédié 4 ha pour la mise en place de jachères pour créer un habitat favorable à la faune sauvage, de bosquets mais aussi de bandes enherbées pour faciliter la présence d'insectes prédateurs naturels des parasites. Pour ce faire, M. Dessaint a signé un contrat ''Gestions de territoire'', financé par le Conseil régional, il y a 5 ans. Résultat : les cultures avec jachère ont favorisé la réapparition de petit gibier sur ces terres notamment celle de la perdrix grise qui trouve également refuge sur les îlots buissonnants implantés par l'agriculteur. 15 couples de perdrix au 100 ha ont été ainsi dénombrés en mars dernier (contre 30 couples en 2005). Ces populations, suivies par la Fédération des chasseurs de la Somme, sont en déclin dû à la prédation mais aussi faute de sites de reproduction avec 2,7 poussins en moyenne par poule d'été.
Les avantages de l'agroforesterie et des prairies fleuries
De son côté, Bruno Haguet, à Verpillères (Somme), a implanté en 2008 une parcelle de 11 ha d'agroforesterie sur une exploitation betteravière de 110 ha, soit 600 arbres et arbustes plantés. Outre ''leur effet brise-vent'', ces arbres (merisier, noyer, sycomore, pommier, poirier…) sont destinés essentiellement au bois d'œuvre à partir d'essences. L'objectif de M. Haguet vise également à produire du bois-énergie (plaquettes, granulés, bûches) ou du bois raméal fragmenté (BRF) qui apporte de la matière organique à la parcelle. Mais ''il faudra attendre 50 ans pour que la production soit rentable'', estime l'agriculteur. Autre avantage liée à l'agroforesterie : le rôle de puits de carbone des arbres qui ''fixent aussi l'azote'' tout étant aussi des zones refuges pour les espèces auxiliaires.
Le Conseil régional de Picardie a ainsi financé à hauteur de 100% l'implantation agroforestière. Cette parcelle fait l'objet de suivis agronomiques réalisés par les Chambres d'agriculture de Picardie et de suivis sylvicoles réalisés par le Centre Régional de la Propriété Forestière. Quatre autres parcelles sont dédiées à l'agroforesterie dans la région.
Parmi les autres techniques agricoles en faveur de la biodiversité préconisées notamment par l'UICN, figure aussi la fauche tardive sur prairie pratiquée par un tiers des éleveurs dans la moyenne vallée de l'Oise (Aisne et Oise). ''Nous fauchons le foin tardivement avec des techniques permettant d'épargner la faune'', indique Guy Leblond, éleveur de bovin charolais. Ainsi ces prairies extensives (intrants raisonnés voire faibles à inexistants) ne doivent pas être fauchées avant le 26 juin, afin de favoriser la flore remarquable (lychnis fleur de coucou, benoîte des ruisseaux, orchis bouffon…), les invertébrés (le papillon ''cuivré des marais'') et laisser le temps aux oiseaux migrateurs nichant au sol de se reproduire comme le râle des genêts, espèce menacée. Depuis près de vingt ans, ce sont environ une trentaine d'éleveurs du secteur qui extensifient 1.200 ha de prairies. En pratiquant la fauche tardive, ces derniers peuvent bénéficier de compensations variant entre 160 et 370 euros à l'hectare, co-financés par l'UE, l'Etat, la région et les agences de l'eau.