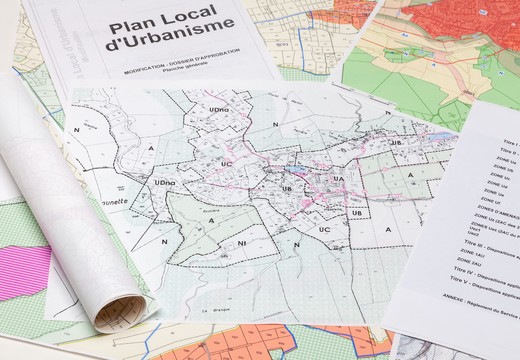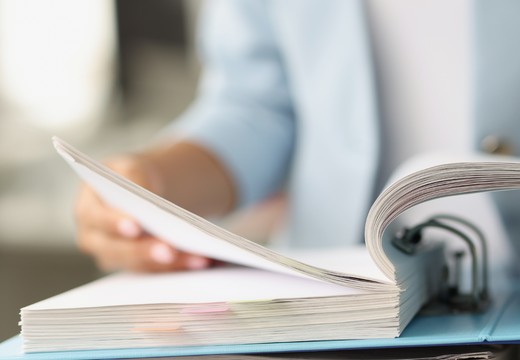Le 5 août dernier, les négociateurs du Canada et de l'Union européenne ont convenu d'une entente finale sur le texte de l'Accord économique et commercial global (AECG) ou Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Le texte partiel de cet accord de 1.500 pages a été diffusé le 13 août par le journal de la chaîne de télévision allemande Tagesschau et repris par le site la quadrature du net (1) , tandis que les négociateurs restaient discrets sur le sujet. Une conférence de presse donnée par les deux parties est attendue pour fin septembre, tandis que des interrogations demeurent sur l'introduction dans le texte d'un panel arbitral, qui permettrait aux investisseurs de déposer une plainte s'ils estiment avoir subi un traitement discriminatoire ou un manquement aux règles de protection des investissements. Les procédures de règlement des différends déclenchent périodiquement des levées de boucliers dans le cadre d'autres traités commerciaux tels que l'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) et le Pacte transatlantique (TTIP), dont la consultation par la Commission a fait ressortir la défiance du public européen.
Une mégamachine commerciale
Les négociations de l'AECG ont été lancées lors du Sommet Union européenne-Canada du 6 mai 2009 à Prague suite à la publication, en octobre 2008, d'une étude conjointement établie par la Commission européenne et le gouvernement canadien sur les bénéfices d'un tel accord commercial : quelque 11 milliards d'euros pour les Européens, et une augmentation de 24% des exportations vers le Canada. En contrepartie de quoi, 93,6% des lignes tarifaires agricoles de l'Union européenne (UE) seront en franchise de droits dès l'entrée en vigueur de l'Accord (contre 18,2% actuellement). L'UE accorde au Canada un contingent supplémentaire de 75.000 tonnes de porc sans droit de douane pour le porc frais, réfrigéré ou congelé ainsi que pour 50.000 tonnes supplémentaires de bœuf. Les produits laitiers canadiens auront accès sans tarif et sans contingentement au marché européen. L'AECG constitue l'accord de libre-échange le plus important négocié par le Canada depuis l'Alena, entré en vigueur en 1994. Du point de vue canadien, il offrira un accès privilégié à un marché de 500 millions de consommateurs européens.
Le droit de l'environnement, figure rhétorique ?
Le Canada et l'Union européenne ont convenu que la valorisation du commerce ne devrait pas se faire au détriment de l'environnement. L'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) affiche des préoccupations relatives à l'environnement et au droit du travail, plus que dans les accords précédents signés par le Canada tels que l'Alena. Selon l'article 25 du texte de pré-accord, les règles de l'AECG ne peuvent empêcher les gouvernements de maintenir ou d'appliquer des mesures nécessaires à la protection de la santé ainsi que de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux. Le chapitre sur l'environnement reconnaît le droit des Etats de réglementer selon leurs propres priorités, tout en encourageant de hauts niveaux de protection environnementale et le droit au respect des accords multilatéraux d'environnement. Les parties s'engagent à gérer de manière durable le commerce des produits forestiers et de la pêche. Le commerce des biens et services environnementaux est encouragé par la réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires. "L'AECG crée des occasions de coopération liées à des sujets d'intérêt commun, tels que les changements climatiques, les biens et services environnementaux, l'utilisation durable de la biodiversité, le cycle de vie des produits, les relations entre le commerce et l'environnement", se félicite le ministère québécois de l'Economie et du Commerce extérieur.
Un mécanisme de règlement des différends ambigu
Mais en cas de litige persistant, les parties sont renvoyées à un autre volet du texte, le chapitre X sur les investissements. Traduit par le blog ContrelaCour (2) , ce chapitre rappelle les obligations des Parties en matière de non-limitation de l'accès à leur marché respectif. On y trouve, parmi les exceptions consenties, les mesures visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, y compris les limitations sur la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, et l'imposition d'un moratoire ou une interdiction. Cela impliquerait-il que, contrairement au régime de l'Alena, une société telle que Lone Pine Resources ne pourrait plus exercer de poursuites contre le moratoire du Québec sur la fracturation hydraulique et l'exploitation des gaz de schiste ?
Là réside une ambiguïté. Selon la clause du traitement de la nation la plus favorisée, chacune des parties doit accorder aux investisseurs un traitement "non moins favorable" que celui accordé à un ressortissant d'un Etat tiers, y compris dans le cadre d'un autre traité dont les parties seraient par ailleurs contractantes, et qui présenterait plus d'avantages et de flexibilités, souligne une note du réseau Seattle to Brussels (3) . Selon le Conseil des Canadiens (4) , "l'article de 25 pages sur les relations investisseur/Etat semble être un classique dans le domaine du règlement des litiges entre investisseurs et Etats – un simple comité de trois personnes chargé de prendre des décisions se substituant à un système judiciaire ayant fait ses preuves. Cela ne suffira probablement pas à apaiser l'Allemagne", poursuivie par l'entreprise suédoise Vattenfall après avoir renoncé à l'industrie nucléaire suite à l'accident nucléaire de Fukushima et opposée à l'introduction d'un tel régime de règlement des différends au sein du traité euro-canadien.