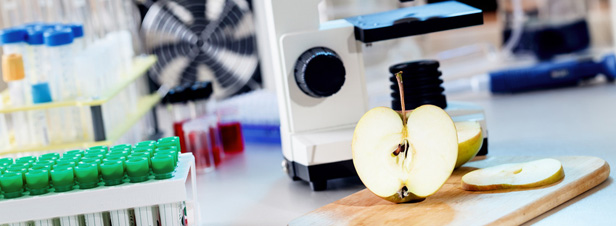L'Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa) vient de publier une nouvelle approche pour l'évaluation des risque (1) s liés à une multi-exposition aux pesticides. Il s'agit de classifier ces substances en groupes d'évaluation cumulée (CAGs), en se basant sur des propriétés toxicologiques similaires, afin d'en évaluer les effets cumulés sur la santé. "Cette approche sera progressivement introduite dans la régulation de l'utilisation des pesticides dans l'Union européenne" en concertation avec la Commission européenne, indique l'Efsa. Celle-ci a déjà testé cette méthode lors de l'élaboration de son rapport annuel sur les pesticides, publié en mars dernier.
La réglementation européenne prévoit de prendre en compte, dans l'encadrement (2) des produits phytosanitaires, les effets cumulés "lorsque les méthodes dévaluation de ces effets existent" (règlements 396/2005 et 1107/2009). Consciente des lacunes méthodologiques existantes à ce sujet, la Commission européenne s'est engagée à présenter, d'ici juin 2014, des lignes directrices pour une meilleure prise en compte des effets cocktails.
Peu de connaissances sur les modes d'action
L'Efsa a fait le choix de l'approche phénomologique, basée sur des observations empiriques, car le mode d'action des pesticides est souvent peu ou pas documenté, alors que l'on sait que de "nombreux composés affectent le même organe et/ou le même groupe de cellules". Ainsi, il s'agit de classer dans un même groupe les substances ayant un effet toxique spécifique sur un organe ou un système, classement qui pourrait s'avérer pertinent lors de la définition de limites maximales en résidus (LMR), estime l'Efsa.
En 2008, le groupe scientifique sur les produits phytosanitaires et leurs résidus (PPR) a publié un avis sur tous les types de toxicité combinée des pesticides, dans lequel il concluait que seuls les effets cumulés résultant d'une exposition simultanée à des substances ayant un mode d'action commun étaient préoccupants et devaient faire l'objet d'un examen plus approfondi.
"La méthodologie de regroupement proposée permet une approche de précaution suffisante, acceptée par la Commission européenne et l'Efsa : quand l'information est insuffisante ou indisponible, il est supposé que les produits chimiques présentant les mêmes effets peuvent avoir un mode d'action similaire, même s'ils présentent un large éventail de caractéristiques structurelles chimiques. Cette opinion est fondée sur des preuves empiriques que des substances chimiquement indépendantes peuvent avoir un effet cumulé sur les organes cibles ou les systèmes d'organes".
Classer les pesticides par propriétés toxicologiques
La méthodologie développée ne s'applique qu'aux pesticides, souligne l'Efsa. Elle ne peut être généralisée aux autres types de produits chimiques potentiellement présents dans les aliments.
Pour former des groupes de pesticides présentant des effets toxiques similaires sur un organe ou un système spécifique, l'Efsa applique une méthode en quatre étapes. Tout d'abord, il s'agit d'identifier "les effets toxiques particuliers et sans ambiguïté qui nuisent à un organe ou à un système". Ensuite, l'Efsa caractérise les dangers, en décrivant la nature précise de l'effet indésirable et en définissant un indicateur relatif au mode d'action du pesticide (hormone…).
S'ensuit la collecte de données relatives aux indicateurs qui pointent vers un effet toxique spécifique dans un organe ou un système. Enfin, l'Efsa regroupe les produits qui présentent un effet toxicologique similaire.
Pour l'instant, l'agence a défini deux groupes : l'un sur les pesticides ayant un effet toxique sur la thyroïde et l'autre sur les pesticides qui impactent le système nerveux central. D'autres travaux préliminaires ont été menés pour les substances ayant des effets sur d'autres organes ou systèmes (foie, yeux, système reproducteur, glandes surrénales).
Par exemple, pour les pesticides ayant un effet sur la thyroïde, l'Efsa a identifié les effets conduisant à un déséquilibre du système thyroïdien et caractérisé l'indicateur le plus approprié pour cet effet : l'hormone. Au total, 103 substances sur 287 recherchées ont été identifiées comme ayant une incidence sur le système hormonal thyroïdien ou sur la thyroïde. Elle a ensuite collecté les données sur les changements de niveaux d'hormones provoqués à la dose où l'effet indésirable se produit. "Cette approche nécessite un jugement scientifique expert car elle implique l'analyse et l'interprétation des grands volumes de données complexes", estime l'Efsa.