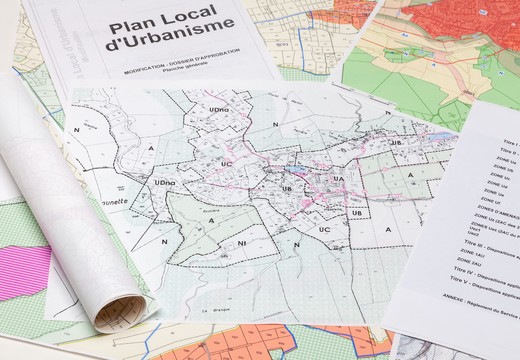Suite à l'accident nucléaire de mars 1980 à Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher), du plutonium a-t-il été rejeté dans la Loire en infraction avec la règlementation ? Si oui, ces rejets ont-ils été dissimulés aux autorités de contrôle ? Telles sont en substance les questions auxquelles devait répondre l'enquête administrative ouverte il y a un an par Ségolène Royal. La réponse à ces deux questions est particulièrement alambiquée : elle "est a priori négative avant décembre 1980 et doit être nuancée après", explique le rapport officiel (1) publié le 26 mai.
En mai 2015, Marcel Boiteux, directeur général d'EDF de 1967 à 1987, a révélé que l'entreprise publique avait rejeté du plutonium dans la Loire suite à l'accident survenu en mars 1980 sur un des réacteurs de la filière "uranium naturel graphite gaz" (UNGG) à Saint-Laurent-des-Eaux. La fusion partielle du cœur du réacteur est connue, contrairement aux éventuels rejets de plutonium. "C'est quand même pas grand-chose", avait-il estimé, expliquant qu'"en cas d'accident il se passe des choses illégales". L'accident de 1980 et le précédent, intervenu sur la même centrale en 1969, sont classés au niveau 4 de l'échelle internationale des événements nucléaires (Ines) graduée de 0 à 7.
En mars dernier, un rapport de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) indiquait que l'analyse de sédiments prélevés dans la Loire en aval d'Angers "montre des pics de concentration en plutonium pour les années 1969 et 1980 qui correspondent à deux accidents intervenus sur la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux".
Vide juridique jusqu'à fin 1980
L'encadrement des rejets des effluents radioactifs "[était] incertain ou peu formalisé au moins jusqu'en 1976", explique le rapport, ajoutant qu'"aucun texte juridiquement opposable ne s'appliquait avant les arrêtés ministériels du 5 juillet 1979" applicables à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux. Au moment de l'accident, les arrêtés qui encadraient ces rejets ne mentionnent pas les émetteurs alpha (dont le plutonium). En conséquence, la réponse est donc "a priori" négative avant fin 1980, puisque la réglementation était lacunaire.
Toutefois, l'absence d'infraction ne veut pas dire que du plutonium n'était pas rejeté. L'enquête administrative explique que "la question des rejets n'était pas ignorée et a été suivie dès la mise en service de la centrale".
A partir de décembre 1980, en vue du démarrage de deux réacteurs à eau pressurisée (REP), de nouveaux arrêtés sont pris pour la centrale. Ils précisent que les rejets liquides et gazeux "ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement". Ces textes, publiés neuf mois après l'accident de 1980, "[imposait] à l'ensemble du site, UNGG comprises, les contraintes de rejet des REP, notamment l'absence d'émetteurs alpha", résume le document.
L'Administration consciente des rejets
Pourtant, "l'Administration était consciente que les [deux tranches UNGG] ne pouvaient pas respecter l'interdiction". Le service en charge de la radioprotection (le SCPRI, à l'époque) "a été ensuite informé de la persistance des rejets", explique le rapport. Un courrier du SCPRI, daté de juillet 1982, demande à EDF de mettre en œuvre une solution "avant la date limite du 31 décembre 1983" et un télex de janvier indique que la "régularisation des rejets (…) doit intervenir au plus vite. Dernière limite acceptable 1er juin 1985, sinon, [le SCPRI sera] dans obligation de demander l'arrêt des rejets en cause". Ces échanges "pouvaient légitimement être compris comme autorisant les rejets", estime le rapport.
Les auteurs considèrent que ce mode de fonctionnement "ne saurait aucunement être tenu pour satisfaisant", notamment au regard de la règlementation actuelle "fondée en particulier sur une séparation stricte entre le contrôleur et le contrôlé".
Concrètement, fin 1980, l'application de l'interdiction des rejets d'émetteurs alpha est impossible "car la centrale ne dispose pas des équipements nécessaires". Un premier dispositif est étudié pour une mise en place après l'été 1983, mais "il a été abandonné en raison de son coût (36 millions de francs)". L'organisme de contrôle "a été informé tardivement par un échange téléphonique en septembre 1983". En décembre 1983, EDF propose d'appliquer à titre expérimental une autre solution. Elle sera mise en place à partir de juin 1985 et "sera reconduite ainsi - sans jamais être transcrite dans une autorisation définitive - jusqu'à l'arrêt de la centrale !". Les rejets incriminés cessent à partir de juillet 1985.
Des traitements possibles, mais difficiles
Concrètement, quelle est la source de ces rejets de plutonium et sont-ils liés à l'accident de 1980 ? Cette pollution "a commencé avant que ne survienne l'accident de mars 1980 et ne paraît pas totalement liée à celui-ci". La première cause, qualifiée de "certaine et importante", est le rejet des eaux des piscines de stockage des combustibles usés polluées par les barreaux de combustible entreposés.
Quant aux accidents de 1969 et de 1980, ils peuvent être une "cause indirecte". Les deux accidents "ont pu conduire" à la mise en suspension d'émetteurs alpha dans le CO2 utilisé pour refroidir les réacteurs. Lors des accidents, du plutonium a pu être mis en suspension dans le CO2. En fonctionnement, de l'eau présente dans le CO2 doit être totalement éliminée (on parle de dessiccation du CO2). Ainsi, le plutonium présent dans le CO2 a pu être collecté avec les eaux de dessiccation.
"Sans que la mission puisse trancher définitivement, beaucoup d'indices suggèrent que la pollution radioactive des eaux de dessiccation du CO2 était une question pertinente et pourrait apporter une origine très plausible à la présence de plutonium ou d'autres éléments métalliques radioactifs dans l'eau et les sédiments de la Loire", conclut la mission.