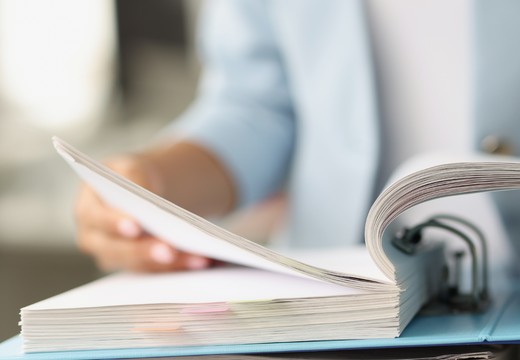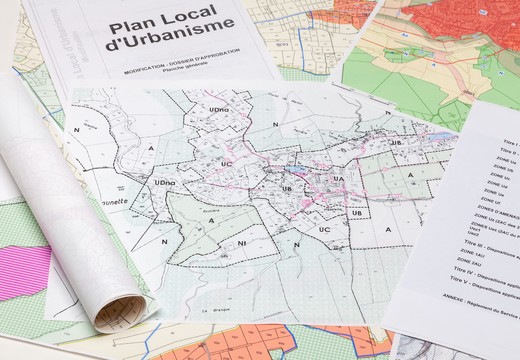Une circulaire relative à l'agrément des associations (1) au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des organisations ayant vocation à siéger au sein de certaines instances environnementales a été publiée mercredi 30 mai 2012.
Le document, daté du 14 mai, a été adressé par le ministre de l'Ecologie aux préfets de région et de département, pour exécution, et à différents services de l'Etat, et en particulier aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), pour information. La circulaire a été validée par le précédent gouvernement, Nicole Bricq ayant été nommée le 16 mai.
Rétablir la légitimité
En premier lieu, la circulaire rappelle les objectifs de la réforme introduite par le décret 2011-832 du 12 juillet 2011. Il s'agit d'"[ajuster] et [clarifier] les règles d'attribution de l'agrément des associations" et de "[déterminer] le socle d'exigences à partir desquelles ces associations, ainsi que certaines fondations reconnues d'utilité publique et organismes pourront être désignés pour
"Cet agrément ayant été accordé sans limitation de durée depuis 1976, rappelle les services du ministère de l'Ecologie, qu'un nombre important d'associations en ont conservé le bénéfice, dont certaines ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions de son obtention". D'où la remise à plat de la procédure d'agrément, qui devient quinquennal, afin d'"en rétablir la légitimité".
La circulaire rappelle en outre que l'introduction de critères de participation aux instances consultatives vise "à garantir une concertation de qualité avec des acteurs représentatifs et légitimes". Un sujet sensible, signale la circulaire, qui attire l'attention sur les risques de contentieux liés à "la désignation (…) d'associations, organismes et fondations qui n'auraient pas été préalablement habilités à siéger en application des nouvelles dispositions".
Quel cadre d'agrément ?
Un des aspects délicats du renouvèlement concerne le cadre territorial de la demande. En effet, les agréments communal, intercommunal et interdépartemental n'existant plus et certaines associations devront revoir le cadre de leur agrément.
"A titre d'exemple, une association bénéficiant aujourd'hui d'un agrément interdépartemental dans une même région peut solliciter un agrément de niveau régional", indique la circulaire sans préciser ce qu'il advient des associations bénéficiant d'un agrément interdépartemental dans plusieurs régions.
Quant aux associations communales, la circulaire sous-entend qu'elles pourraient perdre leur agrément faute d'exercer une activité au niveau départemental. Le document leur suggère de solliciter un agrément dit d'association locale d'usager dont le cadre territorial est communal et intercommunal. Cet agrément relève des articles L. 121-5 et R. 121-5 du code de l'urbanisme.
Concernant l'agrément, le document précise qu'il "ne constitue ni une marque de distinction, ni une récompense pour un engagement occasionnel en faveur de l'environnement mais la reconnaissance par l'Etat d'un engagement effectif et durable dans ce domaine". Cet engagement est jugé au regard de "de plusieurs conditions fondamentales et cumulatives concernant leur objet statutaire, la nature, la réalité et le caractère public de leur activité ainsi que le nombre de leurs membres".
Concrètement, l'Administration doit vérifier que l'objet statutaire relève d'au moins un des domaines mentionnés à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, tels que la protection de la nature, de l'eau, de l'air, des sols, ou des sites et paysages. Ensuite l'association doit œuvrer "principalement" pour la protection de l'environnement. Il s'agit là d'une "condition capitale" et "une association dont seule une partie accessoire de l'activité" relève de ce domaine ne pourra être agréée. Par ailleurs, cette activité doit être exercée depuis 3 ans au moins et avoir un "caractère effectif et public". De même, l'Administration doit vérifier que l'association "rend régulièrement et largement accessible au public son activité et ses prises de positions ou propositions", via diverses publications, par exemple. Enfin, le "nombre suffisant" de membres est jugé par "chaque préfet en fonction du contexte de chaque département ou région" en tenant compte de "la situation démographique de la circonscription administrative considérée ainsi que le caractère plus ou moins généraliste de l'objet statutaire de l'association".
Quant au fonctionnement de l'association, le document rappelle tout d'abord que l'ONG doit justifier, au sens fiscal, d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée. Le deuxième critère concerne les activités qui ne doivent pas être "le résultat exclusif des choix définis par un groupe restreint de personnes". De même, "l'élection démocratique régulière et périodique des dirigeants ainsi que le contrôle effectif de la gestion par les membres constituent (…) des critères importants". Enfin, "la qualité et la régularité des comptes" doivent être vérifiés avec précision par l'Administration lors de l'instruction de la demande.
Les préfets jugent de la participation aux instances locales
En matière de participation aux instances consultatives, la circulaire précise que "l'habilitation est accordée sans distinction pour toutes les instances d'un cadre territorial donné mais elle ne garantit pas la désignation effective pour siéger dans l'une ou l'autre des instances". Les représentants associatifs siégeant dans les instances consultatives concernées siègent jusqu'au terme prévu de leur mandat.
S'agissant des conditions d'éligibilité, le critère relatif au nombre de membre minimal avait suscité de vives critiques de la part de certaines associations, lanceurs d'alerte en tête. Aux niveaux départemental et régional, la circulaire propose de définir un nombre de membres adéquat en tenant compte de critères tels que le tissu associatif local, la démographie du département ou de la région, ou encore en cohérence avec les 2.000 membres (pour les associations) ou les 5.000 donateurs (pour les fondations) retenus au niveau national. De même des critères de répartition géographique des adhérents au sein des départements et régions peuvent être exigés. Il revient aux préfets de publier les arrêtés précisant ces modalités. La circulaire ne revient pas sur l'éligibilité au niveau national.
S'agissant de l'expérience et des savoirs "reconnus" dont doit faire preuve le demandeur, les services de l'Etat se basent sur "le niveau de notoriété dont bénéficient les travaux, recherches et publications ou les « activités opérationnelles » menées".