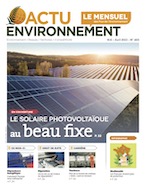Pour continuer à se développer « de manière raisonnée », l'agrivoltaïsme doit être clairement défini et encadré. Sandrine Le Feur, agricultrice et députée LREM du Finistère, et Jean-Marie Sermier, député LR du Jura, ont tenté de relever ce double défi au terme d'une mission d'information « flash » (1) . Cette dernière a été lancée le 5 janvier dernier, et suit des travaux similaires engagés du côté du Sénat. Les deux co-rapporteurs ont présenté leurs conclusions, ce mercredi 23 février, devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.
Le solaire et l'agriculture sur un même pied d'égalité
« Aucune définition légale ou réglementaire ne fait actuellement consensus chez les acteurs du secteur », atteste Jean-Marie Sermier. « Et il est impossible de connaître le nombre exact de projets d'agrivoltaïsme en cours », ajoute Sandrine Le Feur. Pour y remédier, les deux parlementaires appellent d'abord à la création d'un Observatoire de l'agrivoltaïsme, dont le but premier serait de recenser les projets et les bonnes pratiques selon une définition précise. Celle-ci, proposée par les co-rapporteurs, est la suivante : l'agrivoltaïsme constitue la coexistence, sur une même emprise foncière, d'une production agricole significative et d'une production solaire photovoltaïque tout autant significative.
Éviter un développement « irraisonné »
« La production photovoltaïque ne doit pas prendre le dessus sur la production agricole, qui ne serait alors qu'un alibi », souligne le député LR. La jeune association France Agrivoltaïsme estime même, en ce sens, que « la primauté de la production agricole sur la production énergétique doit être inscrite dans une définition légale de l'agrivoltaïsme », afin d'éviter « un emballement déraisonné du nombre de projets photovoltaïques sur foncier agricole ».
Les parlementaires estiment en effet qu'un loyer versé par les exploitants des installations solaires aux agriculteurs (quand ils ne sont pas actionnaires) peut atteindre jusqu'à 5 000 euros par hectare et par an. S'il peut aider les agriculteurs à sécuriser leur modèle économique, ce complément significatif de revenu risque de conduire à une forte hausse des loyers des terres agricoles, voire à un abandon total de la production agricole au profit de la production électrique. « L'agrivoltaïsme ne doit conduire ni à détourner les terres agricoles de leur vocation première, à savoir la production alimentaire, ni à dénaturer le cœur du métier d'agriculteur », avancent les co-rapporteurs. Ainsi, pour éviter le développement de « projets alibis », ces derniers préconisent un encadrement dans la durée : si l'arrêt de la production agricole d'un projet agrivoltaïque est identifié comme « durable », l'exploitation ne doit plus bénéficier des mécanismes de soutien associés.
Ajouter l'agrivoltaïsme aux registres de la Cre et de la Pac
Hormis ce risque posé, l'agrivoltaïsme apporte de nombreux bénéfices et co-bénéfices que les co-rapporteurs souhaitent voir renforcer et préciser. Afin d'encourager les énergéticiens à recourir à l'agrivoltaïsme, les deux parlementaires recommandent une modification des critères des appels d'offre de la Commission de régulation de l'énergie (Cre). Pour bénéficier d'un complément de rémunération associé à une activité agrivoltaïque, un producteur d'énergie doit actuellement candidater à l'appel d'offre « photovoltaïque innovant ». Or, « peu d'installations candidates intègrent une réelle dimension innovante, difficilement démontrable » surtout pour une technologie déjà mâture.
La recherche sur l'agrivoltaïsme accélère
Filiale française de l'énergéticien EnBW, Valeco lance, en collaboration avec l'Institut national de recherche agronomique (Inrae), une expérimentation agrivoltaïque dans un élevage ovin de Charolles (Saône-et-Loire). Pendant trois ans, ce projet de recherche observera les effets de différents types d'installations photovoltaïques sur la ressource fourragère et le comportement des animaux. Sur d'autres exploitations, les chercheurs constatent déjà que l'agrivoltaïsme contribue à une meilleure croissance de l'herbe et offre un abri au bétail, en cas d'intempéries.
En outre, les deux parlementaires encouragent à une meilleure prise en compte de l'agrivoltaïsme par les aides d'État attachées à la Politique agricole commune (Pac). Le cadre actuel n'autorise aucun usage non agricole des terres aidées excédant quinze jours en dehors des périodes hivernales – ce qui n'est pas le cas de l'agrivoltaïsme.
Modifier le code de l'urbanisme
Enfin, dans le respect de la définition qu'elle donne à l'agrivoltaïsme, la mission parlementaire propose d'apporter deux modifications au cadre réglementaire actuel. Le code de l'urbanisme prévoit déjà un aménagement pour l'installation de panneaux solaires sur un terrain agricole, autrement considéré comme inconstructible. Les deux parlementaires souhaitent pourtant le voir modifié, mais proposent deux options opposées.
La première, portée par le député LR, vise à relever le seuil des 3 kilowatts au-dessous duquel aucun permis de construire n'est requis, afin d'augmenter la puissance et le nombre de petits projets agrivoltaïques. La seconde, envisagée par la députée LREM, compte à l'inverse sur une restriction plus large de l'aménagement en question. Celui-ci autorise l'implantation de panneaux solaires seulement s'ils ne seront pas incompatibles avec une activité agricole. Pour respecter la définition avancée par la mission, Sandrine Le Feur recommande que l'installation soit autorisée uniquement si elle permet la pratique d'une activité agricole « significative » - sans pour autant donner de calibrage.