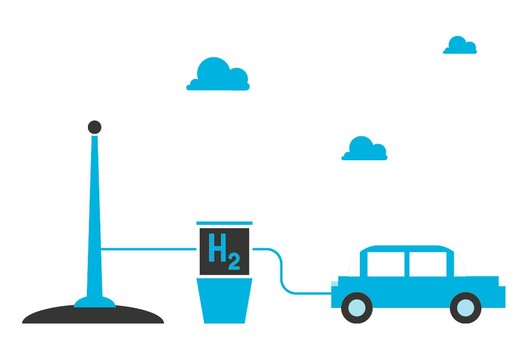"Ce n'est pas un outil qui mesure l'ambition de la France mais un outil neutre qui suit annuellement le respect des objectifs qu'elle s'est fixée", explique Anne Bringault, responsable Transition énergétique au Réseau Action Climat (RAC). L'observatoire climat-énergie, créé il y a un an, a rendu public ce 18 septembre les premiers résultats pour 2018. C'est-à-dire les écarts par rapport aux engagements inscrits dans la stratégie nationale bas carbone (SNBC) de 2015 et la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de 2016.
Les chiffres publiés par cet observatoire, auquel participent le RAC, le Cler, le ministère de la Transition écologique, l'Ademe, Entreprises pour l'environnement (EpE) et l'Iddri, sont globalement mauvais tant en ce qui concerne le climat que l'énergie, même si quelques statistiques prises individuellement donnent satisfaction.
Le budget carbone dépassé de 4,5 %
C'est le cas des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui ont baissé de 4,2 % entre 2017 et 2018, après trois années de hausse. La ministre de la Transition écologique s'en félicite dans un communiqué publié simultanément. Mais cette baisse s'explique surtout par un hiver doux, souligne l'observatoire. D'autre part, ces émissions dépassent de 4,5 % le budget carbone défini par la SNBC. Les principaux secteurs en cause ? Les transports et le bâtiment, qui sont à la fois les secteurs les plus émetteurs et ceux qui ont le plus dépassé leur budget carbone.
Les transports restent toujours le secteur le plus émetteur, avec 31 % des émissions des émissions totales françaises. Une légère baisse (-1,6 %) des émissions est constatée en 2018 par rapport à 2017. "Pour la première fois depuis 2014, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des transports est (…) en baisse", se félicite d'ailleurs Elisabeth Borne. Mais cette baisse est essentiellement due à celle du nombre de kilomètres parcourus par voyageur. Le budget carbone du secteur est dépassé de 12,6 %, avec de très mauvais chiffres pour les émissions des véhicules particuliers neufs (+22,9 % par rapport aux objectifs) et la part du fret ferroviaire et fluvial (-23,9 %).

Les chiffres de l'agriculture sont meilleurs (+2,5 %), mais l'indicateur lié à la surface de légumineuses est mauvais (-37,6 %). D'autre part, il n'existe pas d'indicateurs sur les émissions de méthane des ruminants ni sur celles liées aux engrais azotés. Le secteur de l'industrie est, quant à lui, considéré comme "globalement dans les clous" avec une baisse de -2,8 % entre 2017 et 2018 et un léger dépassement du budget carbone (+ 0,6 %). Mais les meilleurs chiffres restent ceux du secteur de la transformation d'énergie, qui a enregistré une baisse de -15 % des émissions entre 2017 et 2018 et qui se situe à –17 % en-dessous du plafond indicatif annuel.
La consommation d'énergie dépasse de 4,5% l'objectif
Les objectifs en matière d'énergie, définis par la première période de la PPE, ne sont pas non plus respectés. La consommation finale d'énergie a baissé de 1,17 % entre 2017 et 2018 après trois années de hausse. Là aussi, les conditions météo expliquent en grande partie la baisse, qui n'est que de -0,34 % corrigée des variations climatiques. La consommation de l'année 2018 reste supérieure de 4,5 % par rapport à l'objectif de la PPE.
La consommation d'énergies fossiles a baissé de 4 % en 2018 par rapport à 2017, mais la trajectoire dépasse encore de 0,6 % l'objectif de l'année. La consommation de charbon est conforme à l'objectif, ce qui n'est pas le cas du gaz naturel (+ 4,9 %) et du pétrole (+ 8,1 %).
La part des énergies renouvelables (EnR) dans la consommation d'énergie n'est que de 16,5 % en 2018 alors qu'elle aurait dû être de 20,5 %. Soit un écart de 19,5 % qualifié de "très important" par Jean-Baptiste Lebrun, directeur du Cler. Prises individuellement, les filières de l'hydroélectricité (-0,2 %), de l'éolien terrestre (+0,7 %), du bois-énergie (+5,4 %) et de la méthanisation (+10,9 %) sont en phase ou au-dessus des objectifs. Ce qui est loin d'être le cas pour l'éolien en mer (-100 %), l'injection de biogaz (-62,2 %) ou le solaire (-16,4 %).
Enfin, la part du nucléaire dans la production d'électricité a été stable entre 2017 (71,6 %) et 2018 (71,7 %). Soit une production excédentaire de + 6,5 % par rapport à l'objectif pour 2018, fondé sur une réduction de la part du nucléaire à 50% de la production d'électricité en 2025. Un objectif qui est reporté à 2035 par la loi énergie climat en cours de promulgation. De manière générale, l'observatoire a prévu de mettre à jour ses chiffres en fonction des nouveaux objectifs fixés par cette loi et par les nouvelles versions de la SNBC et de la PPE en cours de finalisation.
Redoubler d'effort
"Le message fort qui ressort de ces chiffres, c'est qu'il faut redoubler d'effort", réagit David Marchal de l'Ademe, qui salue toutefois les baisses constatées entre 2017 et 2018. "Cela dépasse les petits changements à la marge, en particulier dans le bâtiment et les transports", réagit Andrea Rudinger de l'Iddri. Pour le chercheur, "une évaluation systématique de l'incidence climatique de tous les projets de loi et de tous les projets d'infrastructures s'impose".
"Les résultats viendront du changement de comportement de l'ensemble des citoyens et pas seulement des décideurs politiques et des entreprises", nuance toutefois Claire Tutenuit, déléguée générale d'Entreprises pour l'environnement. Mais il faut que cela soit compris et accepté", ajoute la déléguée générale de cette association qui représente de grandes entreprises françaises et internationales.