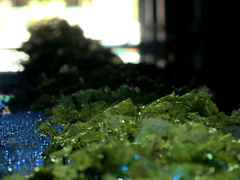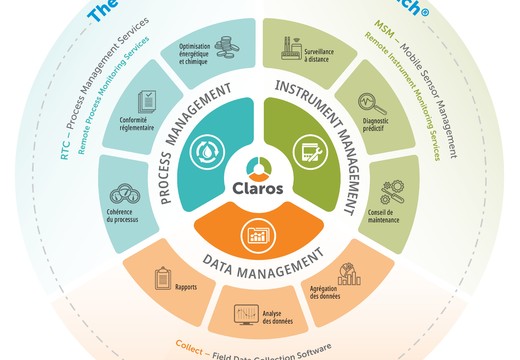La pollution par les nitrates a été moins médiatisée depuis deux ans, même si les algues vertes constituent un problème récurrent dans certains régions comme la Bretagne. La question revient sur le devant de la scène nationale avec le lancement (1) par les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique de la concertation préalable à la révision du programme national « nitrates » (PAN).
Ce programme d'actions répond aux exigences de la directive européenne du 12 décembre 1991 qui, pour lutter contre la pollution diffuse par les nitrates d'origine agricole, impose aux États membres la désignation de zones vulnérables sur lesquelles doivent être adoptés des programmes d'actions. La France a choisi d'articuler un programme d'actions national, commun à toutes les zones vulnérables, avec des programmes d'actions régionaux.
Contentieux européen clos fin 2016
L'Autorité environnementale (Ae) a eu l'occasion de pointer les faiblesses de cette articulation dans le passé. Cette autorité indépendante avait déploré l'absence d'évaluation combinée des programmes rendant impossible la mesure de leur portée environnementale. Elle avait fait ce constat en examinant le projet du sixième programme d'actions entré en vigueur en octobre 2016.
L'adoption de ce plan avait fait suite à une condamnation de la France par la justice européenne en raison du caractère insuffisamment contraignant des programmes d'actions adoptés jusque-là. Malgré certaines lacunes pointées par l'Ae, la refonte du dispositif français depuis 2011 et l'adoption de ce plan ont permis de clore le contentieux européen fin 2016.
Le nouveau programme national doit prendre le relais à compter du 1er septembre 2021. La concertation sur sa révision est réalisée sous l'égide de deux garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP). Cette dernière a jugé que le dossier de concertation (2) préparé par le Gouvernement était assez complet pour engager la concertation.
Concertation, mode d'emploi
La concertation se déroulera du 18 septembre au 6 novembre à travers une plateforme de concertation en ligne. Deux rencontres auront lieu le 18 septembre à Saint-Lô (Manche), conjointement avec le débat public sur la politique agricole commune (PAC), et le 14 octobre à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Un atelier participatif, s'adressant à une quinzaine de membres de l'assemblée citoyenne du débat public sur la PAC, aura également lieu le 10 octobre à Paris.
« La bonne dose, au bon moment et au bon endroit »
Quels sont les enjeux liés à cette révision ? L'exécutif affiche trois objectifs : améliorer l'efficacité des différentes mesures du plan, renforcer la cohérence avec d'autres enjeux environnementaux liés à l'azote, comme la qualité de l'air, et mieux prendre en compte la variabilité climatique. L'enjeu du dispositif réglementaire actuel, rappelle-t-il, est la recherche d'un apport optimal des fertilisants azotés selon la formule « la bonne dose, au bon moment et au bon endroit » afin de limiter les fuites de nitrates. Le plan contient aussi des dispositifs relatifs au stockage des effluents d'élevages, à la création de bandes enherbées ou à la couverture des sols en interculture.
En effet, l'excédent d'azote, qui résulte essentiellement d'apports excessifs d'engrais sur les cultures, est à l'origine de fuites vers les eaux. « Les nitrates figurent parmi les polluants les plus problématiques des eaux souterraines », rappelle le dossier de concertation. Ils impactent la production d'eau potable (coûts supplémentaires, abandons de captages), perturbent les écosystèmes par des phénomènes d'eutrophisation, ainsi que les activités économiques et de loisirs (pêche, aquaculture, tourisme).
« Les concentrations en nitrates des eaux de surface ont baissé depuis les années 1990 », se félicite le Gouvernement. Mais, selon les derniers chiffres disponibles, 25 % des eaux souterraines ont encore une concentration supérieure à 40 mg/L. Elles sont situées dans le Centre-Nord-Ouest, le centre de l'Occitanie, la Camargue et la plaine d'Alsace. Quant aux eaux de surface, 19 % d'entre elles ont toujours une concentration supérieure à 25 mg/L, les teneurs les plus élevées se trouvant dans le Nord-Ouest de l'hexagone. Et il faut garder à l'esprit que 68 % de la surface agricole française reste classée en zone vulnérable.

Un traitement à 90 euros la tonne
Le phénomène des algues vertes est là pour rappeler les conséquences de cette pollution. Dans un rapport (3) publié le 7 septembre, la chambre régionale des comptes de Bretagne pointe le coût de la gestion de ces algues par la commune de La Forêt-Fouesnant (Finistère).
« Depuis 2010, les collectivités du pays Fouesnantais, avec le soutien de l'État, ont mis en place une organisation performante. (…) Toutefois, le coût de cette politique augmente : de 15 euros la tonne en 2010, celui-ci est passé à 90 euros la tonne en 2019, l'État prenant à sa charge environ 80 % de cette dépense. Ce sont ainsi en moyenne 227 000 €/an qui restent à la charge de l'ensemble des contribuables fouesnantais et forestois », rapporte la juridiction financière.
« Il y a des algues vertes en Bretagne parce qu'on a développé un modèle agricole breton basé sur le productivisme, qui fait du tort à la fois aux paysans et à l'environnement », a rappelé Morgan Ody de la Confédération paysanne sur France 3 Bretagne à l'occasion d'un rassemblement associatif début août à Lorient (Morbihan).
Avec cette révision, le Gouvernement affiche l'objectif de « concilier la performance économique des activités agricoles et le respect des exigences environnementales ». Mais il va devoir accélérer son soutien à l'agroécologie s'il ne souhaite pas voir les externalités négatives de l'agriculture intensive devenir exorbitantes.