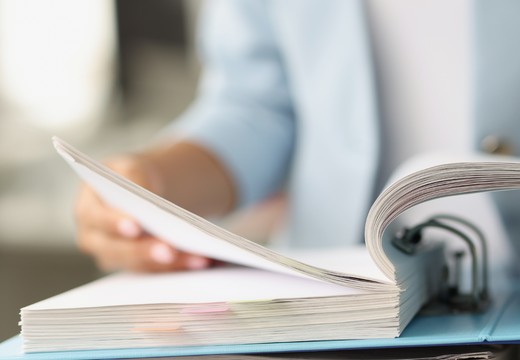Si le mystère plane toujours sur l'identité du navire responsable du rejet en mer de fuel lourd au large de la Corse, l'événement est révélateur d'une pratique, qui semble profiter d'une relative impunité. « Pour l'instant, la règle c'est : pas vu, pas pris, regrette Antidia Citores, porte-parole de Surfrider Foundation. Dans ce cas, pour la seconde fois (1) cette année, en Méditerranée, il y a une tentative de remontée à la source de la pollution ».
La détection des deux nappes d'hydrocarbures d'environ 35 km au large des côtes corses est en effet fortuite : cette pollution a tout d'abord été repérée lors d'un exercice mené par l'armée de l'air de la base aérienne de Solenzara. Sa confirmation par un avion Falcon a ensuite déclenché l'ouverture d'une enquête judiciaire et l'activation du plan Polmar terre.
« Habituellement les débalastages sauvages sont réalisés quand la mer est plus formée, pas un jour de beau temps comme nous avons connu vendredi dernier », pointe Nicolas Tamic responsable des opérations au Centre de documentation de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre). Généralement, les contrevenants profitent également des découpages territoriaux pour nettoyer leurs cuves. « Les navires vont choisir des pays où le risque économique à polluer est le plus faible, constate Antidia Citores. Ils préfèrent également agir la nuit ».
Pour tenter de contrer ces rejets illicites, l'Europe s'est dotée d'un service de détection satellite des nappes d'hydrocarbures et des navires, CleanSeaNet, pleinement opérationnel depuis décembre 2010. « En 2019, il y a eu 7 939 détections, indique Antidia Citores. Sur la base de ces détections, des avions Falcon sont diligentés pour recouper les informations, parfois un échantillonnage est réalisé, si la substance est encore présente ». Un faible laps de temps entre l'acquisition des images par satellite et la vérification est alors capital pour que celle-ci soit pertinente. Une réalité encore difficilement applicable sur le terrain. Un projet de rapport de l'Agence européenne de sécurité maritime indique qu'en 2019 seulement 5 % des vérifications ont été effectuées dans les trois heures après l'observation satellitaire. Et pour cette petite part, dans 47 % des cas, rien n'a pu être observé, dans 31 % ce sont d'autres substances qui ont été retrouvées (huile de poisson, huile végétale, eaux usées ou ordures, etc.) et dans 11 % des cas le rejet d'hydrocarbure est confirmé.
Une course contre la montre
Dans le cas des deux nappes repérées au large de la Corse, le laboratoire de la marine nationale de Toulon (Var) a pu analyser les polluants. Trois bateaux sont suspectés d'être à l'origine de la pollution. Dans le cadre de l'enquête, des comités de la gendarmerie maritime ou des pays de l'escale pourraient les accueillir à leur arrivée dans un port. « C'est une course contre la montre, note Antidia Citores. Nous appelons à une coopération entre les ports d'accueil des prochaines escales des trois navires soupçonnés pour qu'il y ait des inspections à bord et pouvoir dans un temps raisonnable corroboré les premiers faisceaux d'indices : données satellitaires, de la dérive des nappes, du transpondeur (2) ». Dans ce cadre, l'association a porté plainte contre X.
Une modélisation à « rebours » est également envisagée : le cheminement de la nappe d'hydrocarbures depuis le jour de sa découverte va alors être retracé. Cette option n'est toutefois pas infaillible. « Il faut que les bateaux aient été bien ciblés », explique Nicolas Tamic.
Le trafic maritime dans cette zone est en effet important. « Si leur sillage est à proximité, cela peut être compliqué de savoir lequel a rejeté la pollution, souligne Antidia Citores. Dans tous les cas, cette seule preuve de la dérive des nappes ne suffira pas à confondre l'auteur. Il faudra y additionner les registres de bord, des auditions de l'équipage, un témoignage du capitaine, la route empruntée, etc. Il faut également qu'il y ait eu l'intention de déverser ».
Si l'auteur de la pollution est identifié, la sanction pourrait être conséquente. « En France, c'est le capitaine qui est poursuivi avec une forme de solidarité prévue par les textes avec l'armateur, explique Antidia Citores. L'arsenal français prévoit jusqu'à 15 millions d'euros d'amende : vu les caractéristiques de la nappe et les faits, nous pouvons penser que le jugement sera sévère d'autant plus qu'à aucun moment, il a été question d'une avarie qui pourrait justifier, pour des raisons de sécurité, de vider les cuves ». Toutefois, là encore, des obstacles pourraient entraver la procédure. « Durant les six mois qui suivent le constat de l'infraction, le pays dans lequel est immatriculé le navire peut demander à juger l'affaire et appliquer les sanctions prévues dans sa législation, pointe Antidia Citores. Je ne vous cache pas que les parties adverses ont tendance à vouloir extraire les affaires hors de France ».
Un nettoyage en cours
Le volume d'hydrocarbures rejeté par le navire n'a pas pu être estimé. « D'après les informations des préfectures, nous sommes en présence d'un mélange avec du fuel très lourd et très visqueux, indique Nicolas Tamic. Ce qui fait que les opérations de ramassage en mer semblent efficaces : comme le pétrole est très visqueux, il reste dans les mailles des chaluts. Mais il faut travailler vite. En mer, le pétrole se transforme : une partie s'évapore, une partie s'émulsionne avec l'eau environnante, s'alourdit et passe entre deux eaux, les navires peuvent passer à côté. Peu à peu la nappe qui était compacte se morcelle au grès des courants, de la photoxydation, et se transforme en boulette ou galette ».
Des résidus ainsi transformés ont été retrouvés lundi 14 juin sur une plage de la municipalité corse de Solaro. Selon la préfecture maritime de la Méditerranée, le dispositif de ramassage est en cours de réadaptation avec des moyens adaptés. « Pour ne pas aggraver la pollution, il faut faire un nettoyage sélectif, éviter par exemple de ramasser aussi des posidonies, ou des sédiments », explique Nicolas Tamic.
Reste désormais à attendre les résultats de l'enquête pour savoir si les préjudices économiques et écologiques pourront être dédommagés.
La Corse a d'ores et déjà annoncé qu'elle engagerait deux actions en justice : une plainte pénale auprès du Parquet et une procédure de référé devant le Tribunal administratif de Bastia pour permettre des prélèvements et constatations, utiles dans le cadre d'une action indemnitaire.