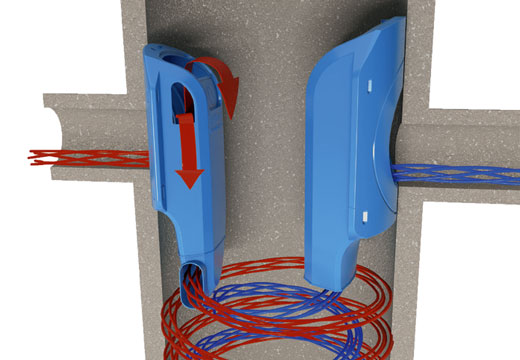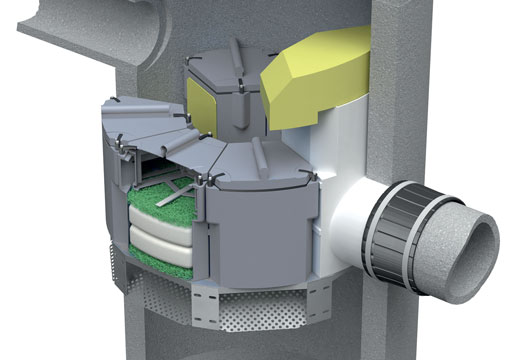Un remplissage prévu d'ici à fin décembre ou début janvier : le calendrier des opérations de l'une des premières retenues de substitution (1) sur les seize prévues dans le bassin de la Sèvre niortaise amont et du Mignon (Deux-Sèvres) devrait se dérouler comme prévu. L'interrogation sur le caractère de zone humide du site – et donc sur la légalité des travaux à cette période de l'année – a, en effet, été levée par le préfet. « Toutes les zones humides sont épargnées et préservées. Les travaux engagés sont bien conformes à l'arrêté préfectoral pris en 2017 et peuvent se poursuivre en toute légalité », a indiqué, dans un communiqué, la préfecture des Deux-Sèvres, le 30 novembre.
Cette emblématique retenue, dite de Mauzé-sur-le-Mignon, fait partie de celles cristallisant l'opposition d'associations environnementales, comme le collectif Bassines Non merci, et certains syndicats agricoles comme la Confédération paysanne. « Nous sommes sur un secteur où la culture de maïs destiné à l'élevage – voire à la méthanisation – est majoritaire. Sommes-nous obligés d'être autant dépendants d'une plante qui a besoin d'eau au moment où les tensions sur la ressource sont les plus fortes pour notre système d'élevage ? Il faudrait nous donner les moyens de revoir ce que nous irriguons pour être moins dépendants d'une ressource qui est amenée à baisser, argumente Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne. Nous contestons à la fois le dimensionnement des mégabassines – en moyenne de la taille de huit terrains de foot – et la privatisation de la ressource qui en découle. Non seulement, elles ne permettent pas une réorientation du modèle agricole, mais elle pose un problème d'égalité d'accès à l'eau de l'ensemble des agriculteurs alors qu'elles bénéficient d'un soutien financier public. »
Devant les vives contestations, plusieurs processus de conciliation ont été engagés. Un protocole d'accord a ainsi été signé (2) , le 18 décembre 2018, par la préfecture des Deux-Sèvres, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental, la chambre d'agriculture, la coopérative de l'eau - porteuse du projet -, le parc naturel régional du Marais poitevin, la fédération départementale de la pêche ainsi que l'association environnementale Deux-Sèvres Environnement. Cette négociation s'intègre plus largement dans une démarche « cousine » des projets de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE), c'est-à-dire un contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ).
Des engagements des agriculteurs en contrepartie des réserves de substitution
Le protocole d'accord (3) prévoit une contrepartie à ces volumes d'eau stockés destinés à l'irrigation : il demande des actions pour qu'évolue l'agriculture dans le secteur. Les agriculteurs doivent ainsi s'engager à suivre des formations sur les solutions alternatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, au pilotage de l'irrigation ainsi qu'à l'agroécologie. À ce premier niveau, ils peuvent également ajouter des engagements complémentaires sur la réduction des intrants, leurs pratiques culturales ou la préservation de la biodiversité. Au total, collectivement, un objectif de réduction de 50 % de l'usage des phytosanitaires a été fixé.
Le document prévoit également une réduction des volumes destinés à l'irrigation par rapport au projet initial (désormais de 12,7 millions de mètres cubes au lieu de 15,6 auparavant), supprimant de ce fait trois retenues sur les 19 prévues (4) . « En comparaison à la situation actuelle, [le projet] ne constitue pas un développement de l'irrigation et apporte une plus-value aux milieux aquatiques en période d'étiage, notamment l'alimentation en eau du Marais poitevin (5) , à la disponibilité de la ressource en eau potable et à la biodiversité », souligne le protocole d'accord.
Le document annonce également un schéma directeur relatif à la préservation de la biodiversité aquatique et terrestre, copiloté par la chambre d'agriculture et la Direction départementale des territoires (DDT) des Deux-Sèvres. Il décline des actions en faveur de la préservation de la biodiversité aquatique et terrestre, comme la mise en place de bandes fleuries ou de jachères mellifères, la plantation de haies, l'agroforesterie, la renaturation de certains cours d'eau, la restauration de zones humides, etc.
Le volume de neuf réserves à revoir
Un certain nombre d'évolutions au projet vont également être apportées en raison d'une décision de justice. À la suite d'une requête d'associations environnementales, le tribunal administratif de Poitiers (10) a, en effet, demandé, en mai dernier, la révision du volume annuel maximal pour neuf des seize réserves prévues. Il considère que seules les dix années précédant la date de délivrance de l'autorisation environnementale peuvent servir de référence pour la détermination du volume annuel maximal. « Nous avons adapté la volumétrie pour chaque réserve concernée, comme demandé dans le jugement : nos données commençaient en 2006 et le juge demande qu'elles débutent en 2007. Sur cette base, nous avons réduit le volume pour l'ensemble des neuf réserves de 1,2 million de mètres cubes, précise François Pétorin, agriculteur administrateur de la coopérative de l'eau. Nous les avons soumis à la Direction départementale des territoires, le préfet prendra ensuite un nouvel arrêté intégrant les nouveaux volumes. »
Le juge a également établi que, dans le cadre du contrôle de conformité, il convient de tenir compte du volume total de la réserve et pas seulement du volume utile (11) .
Les résultats du protocole d'accord remis en cause
Si le protocole d'accord semblait être un bon compromis pour plusieurs des parties prenantes, son application l'est beaucoup moins. Les avancées des engagements pris sont ainsi remises en question par certains –considérées comme trop lentes ou manquant d'ambitions. L'association Deux-Sèvres Nature Environnement a ainsi choisi, le 19 octobre dernier, de sortir des instances de suivi et d'arrêter toute participation au processus, « en raison de l'insuffisante prise en considération de ses demandes et analyses ainsi que du non-respect de certains engagements », explique-t-elle. Une déception que partage également Delphine Batho. Dans une lettre (12) adressée au ministre de l'Agriculture, en novembre dernier, la députée des Deux-Sèvres appelle à stopper les travaux. « Il est manifeste depuis plus d'un an que le protocole d'accord pour une agriculture durable dans le territoire du bassin Sèvre Niortaises-Mignon (…) n'est aucunement respecté », estime-t-elle.
Les agriculteurs signataires des engagements pointent, quant à eux, le temps que demandent les changements. « Les engagements sont pris réserve par réserve, les agriculteurs les mettent en place à partir du moment où ils ont accès à l'eau sécurisée. Comme les travaux sont programmés selon plusieurs lots, nous ne pouvons pas tout faire la même année, souligne François Pétorin. Des mesures comme la plantation de haies pourront s'étaler sur deux ou trois ans ; une conversion à l'agriculture biologique nécessitera trois ans… »
Quelle vision de l'agriculture pour demain ?
Des projets de retenues de substitution en émergence
En Charente-Maritime, un autre projet provoque le débat : la retenue de substitution prévue sur la commune de Cram-Chaban. Inscrite dans un projet de cinq ouvrages, elle se trouve au cœur d'une bataille, notamment juridique. « Le 17 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a reconnu l'existence de vices tirés des insuffisances de l'étude d'impact et de l'absence d'instruction de la demande d'autorisation, souligne la Confédération paysanne. La cour d'appel a estimé que ces vices sont régularisables et a donc accordé à l'Asai [Association syndicale autorisée d'irrigation] des Roches un délai de six mois pour procéder à la régularisation des vices. » L'association considère que durant ce laps de temps, le fonctionnement de l'ouvrage est illégal. « Une nouvelle enquête publique sur les compléments à l'étude d'impact a été menée. Le 4 novembre 2021, la commissaire enquêteuse a rendu un avis défavorable », pointe-t-elle.
Dans la Vienne, dans le bassin-versant du Clain, le contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) prévoit 41 retenues de substitution. Celles-ci ont fait l'objet de nombreux recours.
Cette sécurisation est également l'un des objectifs poursuivis par le Varenne agricole de l'eau en cours. L'engagement de ces travaux a été salué par une partie des acteurs, comme la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : « Tous les travaux du Giec et des météorologues convergent vers la certitude de pluviométries annuelles maintenues en volume, mais très déséquilibrées entre périodes hivernale et estivale, a souligné la fédération lors du lancement du Varenne. Il faut donc gérer l'eau "en bon père de famille" : la stocker l'hiver, quand elle est abondante, pour l'utiliser l'été, en période de pénurie. Seule cette irrigation de résilience apportera des garanties de productions alimentaires. »
D'autres acteurs sont plus critiques, à l'instar de la Confédération paysanne, la Fédération nationale d'agriculture biologique, l'UFC-Que Choisir, France Nature Environnement et le Réseau Action Climat, qui estiment que ces réflexions reposent sur une parodie de consultation. Le conseil scientifique du comité de bassin Seine-Normandie s'est également montré méfiant : « De nombreux aspects de ce Varenne inquiètent le conseil scientifique : il va se dérouler dans un délai très court (six mois) en n'associant qu'une partie des acteurs de l'eau, indique-t-il dans un avis (13) . La notion de "gisements" d'eau utilisée est totalement inadaptée car la ressource est plus un flux qu'un stock, et un flux en interaction avec des milieux vivants. Par ailleurs, à rebours des approches de gestion intégrée de la ressource, le Varenne se focalise exclusivement sur la question de l'eau agricole, et plus précisément encore de l'eau d'irrigation. »
Le comité de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (14) appelle également à la prudence lors du choix de faire appel à ce type de solution. «Les infrastructures dites de substitution font partie de ces actions sur l'offre pouvant représenter une assurance contre le risque de pénurie d'eau, reconnaît-il. Or leur création peut conduire à l'apparition de certains effets pervers à plusieurs niveaux : des modifications de l'assolement et/ou une augmentation de la surface irriguée (…), une détérioration non prévue de la qualité globale des ressources en eau (…), une réduction des apports en sédiments et nutriments dommageable au milieu marin (…), des conséquences non attendues sur les parties situées en aval ».
Face au réchauffement climatique, le conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité (15) a, quant à lui, pointé la nécessité d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole (16) , mais également une réduction des impacts sur l'eau et la biodiversité. « La littérature scientifique a notamment mis clairement en évidence les risques liés à une amélioration de l'accès à l'eau pour l'agriculture : faciliter l'accès, c'est souvent retarder les changements des systèmes agricoles, c'est aussi amplifier la consommation en eau par la poursuite et le développement de systèmes consommateurs d'eau, note le conseil. Il peut en résulter, au final, une nouvelle dépendance à l'eau des exploitations agricoles, parfois plus forte qu'initialement. L'augmentation de la mobilisation de l'eau entraîne également des impacts sur la qualité des écosystèmes. » Ce dernier appelle à promouvoir une transformation systémique de l'agriculture.
Reste à voir quelles seront les pistes finalement retenues par le Varenne agricole de l'eau.