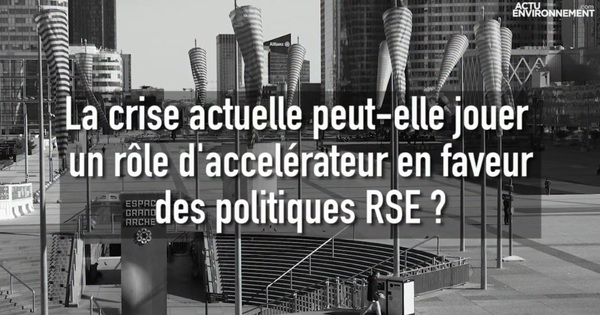Le 23 février, la Commission européenne a présenté son projet attendu de directive qui impose aux entreprises un devoir de vigilance (1) en matière d'atteintes aux droits humains et à l'environnement. « La présente proposition vise à atteindre deux objectifs. Premièrement, répondre aux préoccupations des consommateurs qui ne souhaitent pas acheter des produits issus du travail forcé ou détruisant l'environnement, par exemple. Deuxièmement, soutenir les entreprises en apportant une sécurité juridique quant à leurs obligations au sein du marché unique. Cette législation promouvra les valeurs européennes dans les chaînes de valeur, de manière équitable et proportionnée », a déclaré Věra Jourová, vice-présidente de la Commission européenne, en charge de la défense des valeurs de l'Union et de la transparence.
13 000 entreprises européennes concernées
Le projet de directive s'appliquerait aux grandes entreprises comptant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d'affaires (CA) annuel supérieur à 150 millions d'euros. Deux ans après l'entrée en vigueur du texte, dans certains secteurs à risques (industrie textile, agriculture, extractions de minerais), ce seuil serait abaissé aux entreprises qui emploient plus de 250 personnes et réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus 40 millions d'euros.
Ainsi, environ 13 000 entreprises européennes et 4 000 de pays tiers opérant dans l'UE seraient soumises au devoir de vigilance. Le périmètre d'application de la directive serait donc plus large que celui de la loi française adoptée dès 2017. Elle ne concerne actuellement que les grandes entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 en France et à l'étranger (soit environ 250 entreprises visées).
Comme la loi française, la proposition de la Commission prévoit de contraindre les entreprises à mettre en place des mesures de prévention des atteintes aux droits humains et à l'environnement commises par leurs filiales, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants directs et indirects. En cas de manquement, leur responsabilité pourrait être engagée, et elles pourraient être tenues d'indemniser les personnes affectées. Les États membres devraient aussi veiller à ce que les entreprises se conforment à leurs obligations de devoir de vigilance, et ils pourraient leur infliger des amendes en cas d'infraction. En France, le Conseil constitutionnel avait cependant retoqué l'amende civile de dix millions d'euros qui était initialement prévue par la loi française adoptée en février 2017.
La directive ne concerne pas les petites et moyennes entreprises (PME). « Néanmoins, elles pourraient être indirectement touchées par les nouvelles règles, à la suite d'actions menées par les grandes entreprises à travers leurs chaînes de valeur. C'est pourquoi, la proposition prévoit un soutien spécifique destiné aux PME, sous la forme notamment d'orientations et d'autres outils conçus pour les aider à intégrer progressivement les considérations de durabilité dans leurs activités commerciales », précise la Commission.
Plans de transition climatique obligatoires pour les grandes entreprises
Par ailleurs, les entreprises, de plus de 500 salariés et de CA annuel de plus de 150 millions d'euros, devraient aussi disposer d'un plan permettant de « garantir que leur stratégie commerciale est compatible avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C conformément à l'Accord de Paris ». De même, lorsque les administrateurs des entreprises bénéficient d'une rémunération variable, le projet de texte les encourage à contribuer à la lutte contre le changement climatique en se référant au plan d'entreprise.
Le député européen Pascal Canfin (Renew) salue cette obligation de plan de transition pour les grandes entreprises : « Ce plan devra être rendu public dans le rapport extra-financier des entreprises prévu dans la directive en cours de négociation (CSRD). Cette obligation de mettre en place un plan de transition, couplée à l'obligation de transparence de la CSRD est un pas en avant important pour aligner les modèles économiques et les stratégies des entreprises avec l'Accord de Paris ». En revanche, M. Canfin juge que la disposition sur la rémunération variable est « trop limitée et pas assez ambitieuse, car elle rend obligatoire de lier le plan de transition à la part variable de la rémunération des dirigeants… uniquement dans les entreprises qui ont mis en place un dispositif adossant le calcul des bonus avec la performance environnementale ».
Des lacunes pointées par les ONG
Elles déplorent aussi l'« approche très restrictive » de la Commission en matière environnementale. « Les atteintes à l'environnement se limitent, d'une part, à des violations de certaines normes de droit international limitativement énumérées dans une annexe (2) . D'autre part, la Commission retient une approche anthropocentrique du dommage environnemental conditionnée à ce que la dégradation de l'environnement ait des répercussions sur certains droits humains (droit à l'eau, à la santé etc.). »
Il revient désormais au Parlement européen et au Conseil des ministres de l'UE « d'améliorer le texte », estiment les associations. Une fois adoptée, les États membres auront deux ans pour transposer la directive en droit national.