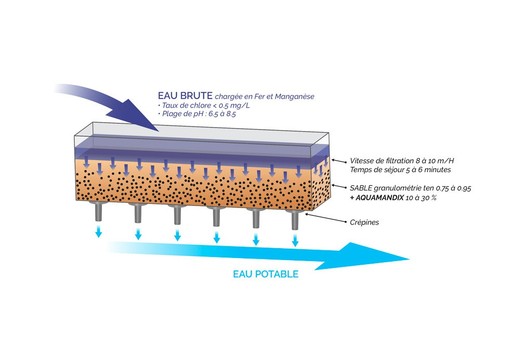La définition des points d'eau est un sujet sensible. S'ajuste en effet sur celle-ci le périmètre, plus ou moins élargi, de la protection des ressources aquatiques face aux pollutions agricoles.
Sur le terrain, l'application du cadre national s'avère inégale selon les territoires et reste un sujet de polémiques. "Dans de nombreux départements, le jeu d'acteurs et les rapports de force locaux ont conduit à une réduction, parfois forte, du réseau hydrographique protégé par des zones non traitées, constate le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER). Alors que la protection de l'ensemble de ce réseau est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité des eaux superficielles et réduire les coûts de potabilisation".
Dans un rapport (1) , les deux services ministériels proposent des pistes pour améliorer l'identification des zones à protéger. Ce document est publié dans un contexte particulier : l'arrêté de mai 2017 qui contribuait à cette identification des points d'eau a été partiellement annulé par le Conseil d'Etat. Pour la haute juridiction, les dispositions réglementant l'utilisation des pesticides ne protégeaient pas suffisamment la santé publique et l'environnement.
Une application complexe
L'élaboration en mille-feuille de la définition d'un point d'eau a contribué à la complexité de son application. Se juxtaposent les zones de non traitement (ZNT), les zones tampon de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) et les cours d'eau à protéger au titre de la police de l'eau.
Le cadre des BCAE
Le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales impose notamment que les exploitants agricoles mettent en place une bande tampon de 5 mètres de large au minimum, sans traitement phytopharmaceutique ni fertilisation, le long des cours d'eau. Un couvert, qu'il soit herbacé, arbustif ou arboré, implanté ou spontané devrait également y être maintenu.
En treize ans, le ministère de l'Agriculture a donné quatre définitions successives et autant de listes des cours d'eau qui doivent respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). A cela s'ajoute une remise en cause de la définition par des jurisprudences. "La jurisprudence ayant, en France, une valeur supérieure à celle d'un décret, elles remplacent la définition des cours d'eau donnée par décret, rappelle le rapport.
Le fameux arrêté de mai 2017 propose quant à lui une définition (2) qui cumule une référence aux cartes IGN et aux cours d'eau soumis à la police de l'eau. Pour les deux Conseils, cette prise en compte cumulée est une garantie de non régression du linéaire protégé. Toutefois, "en additionnant les référentiels, la réglementation a accru les ZNT alors même que la réglementation antérieure n'était pas pleinement appliquée", soulignent-t-ils.
L'instruction (3) du gouvernement envoyé aux Préfets en mars 2017, ambiguë, n'a pas contribué à améliorer la situation. Elle renvoie en effet la définition des points d'eau à un arrêté préfectoral. Ce qui implique qu'"en l'absence d'arrêté préfectoral de définition des points d'eau, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, et l'épandage, la vidange ou le rinçage des effluents sont libres de toute contrainte de distance vis-à-vis des points d'eau et ne sont soumis qu'à l'interdiction générale d'application directe sur les éléments du réseau hydrographique", dénoncent le CGEDD et le CGAAER.
Au final, seulement un quart des arrêtés préfectoraux pris reprennent les références cumulatives de l'arrêté de mai 2017. "Les arrêtés préfectoraux qui ont exclu soit des éléments hydrographiques présents sur la carte IGN, soit des cours d'eau "police de l'eau", doivent réintégrer ces éléments s'ils sont présents sur le territoire dans un délai compatible avec la nécessité d'un dialogue entre l'ensemble des parties prenantes", estiment, dans leur rapport, les deux Conseils.
Trois départements restent toujours dépourvus d'arrêté préfectoral définissant les points d'eau : le Pas-de-Calais, La Réunion et Mayotte.
S'appuyer sur le nouveau référentiel cartographique Topage
Pour les deux services ministériels, une amélioration de la situation passe par un appui sur une carte commune. "Dans notre société, qui se base sur une communication visuelle, il faut aller vers une représentation physique unique stable dans le temps et facilement accessible, du réseau hydrographique concerné par cette réglementation vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques, mais également des autres réglementations, expliquent-t-ils. La réticence des associations environnementalistes devrait pouvoir être levée dès lors que la cartographie est exhaustive et réalisée en partenariat, comme cela est le cas en Bretagne".
Et ils ont identifié pour cela une opportunité : l'IGN et l'Agence française pour la Biodiversité (AFB) doivent construire un nouveau référentiel cartographique – baptisé Topage - d'ici fin 2019. Ce dernier sera issu du rapprochement entre leurs bases de données (4) . Le CGEDD et le CGAAER proposent de réfléchir à une inscription des cartographies produites à partir de ce futur référentiel, dans la réglementation - cours d'eau "police de l'eau", arrêté ministériel ZNT, zones tampons BCAE - en remplacement de la cartographie IGN 1/25 000e actuelle. "Il serait aussi souhaitable que le ministère de l'Agriculture abandonne toute référence spécifique aux zones tampons BCAE ", estiment-ils.
Ils recommandent également la mise en place de guide de bonnes pratiques dans les secteurs sensibles. "En cas d'échec, prendre un arrêté préfectoral imposant l'interdiction d'épandre à moins d'un mètre des éléments linéaires non identifiés sur les cartographies, en bord de champs ou de route", arbitrent-t-ils.
Enfin, les deux conseils préconisent que les contrôles des pratiques ne doivent pas se limiter aux zones à enjeux. Ils considèrent que le contrôle des pulvérisateurs doit devenir systématique et incontournable pour obtenir des primes PAC.