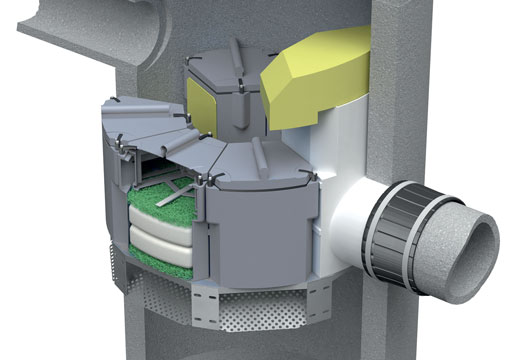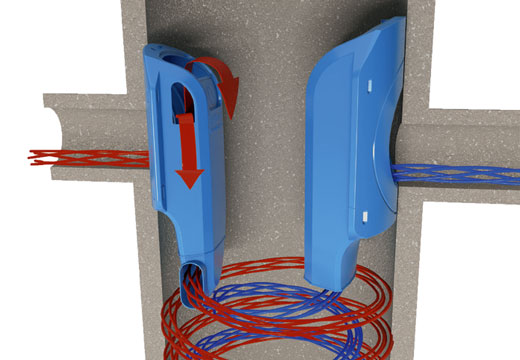"Les observations sur les quatre dernières décennies alertent sur les tensions dont l'eau fait l'objet, voire questionnent sa pérennité face à une multitude d'usages. Dans le futur, ces déséquilibres entre disponibilité et demande pourraient être exacerbés par de grands changements globaux : croissance démographique, urbanisation, changement climatique…", note le Centre d'études et de prospective (Cep) du ministère de l'Agriculture, dans une analyse sur la place du secteur agricole face à la disponibilité future de la ressource en eau (1) .
Le Cep compare les résultats de trois études prospectives sur la ressource en eau (Aqua 2030 (2) , Garonne 2050 (3) et Explore 2070 (4) ). Toutes partagent un même constat : l'offre va être impactée par le changement climatique (évolution des températures, des régimes de précipitation, multiplication des périodes de sécheresse…) tandis que la demande devrait augmenter (croissance démographique, production énergétique, agriculture, industrie…). Résultat : les scénarios tendanciels ne sont pas soutenables. Dans Garonne 2050 et Aqua 2030, les usages environnementaux de l'eau sont les principales victimes d'une trop forte pression sur la ressource : "Les milieux naturels s'y trouvent fortement impactés par les dynamiques déjà à l'œuvre dans les territoires". Quant au secteur agricole, les situations diffèrent selon les études : diminution des surfaces irriguées dans Garonne 2050, augmentation des prélèvements pour satisfaire l'agriculture intensive dans Aqua 2030 et demande agricole non satisfaite dans Explore 2070…
"Ces exercices concluent tous que les tensions vont s'exacerber à l'avenir, forçant l'agriculture à s'adapter, sous l'influence du changement climatique ainsi que des autres prélèvements d'eau". Cela passe notamment par une adaptation des espèces et des variétés cultivées, une évolution des pratiques, de l'irrigation…
Quel degré de priorité donné à l'agriculture ?
Les trois études prospectives proposent des scénarios de sobriété, dont l'objectif est le respect des objectifs de la directive cadre sur l'eau (Aqua 2030) ou l'atteinte d'un débit environnemental des rivières satisfaisant (Garonne 2050). "La satisfaction de l'objectif de « sobriété », dans ces exercices, met en évidence une agriculture qui devra s'adapter, parfois radicalement", souligne le Cep.
Selon les scénarios, la hiérarchisation des usages diffère. Dans Explore 2070, l'agriculture devient "une variable d'ajustement", placée en dernière position dans l'échelle des usages. Dans ce scénario, la totalité des surfaces en maïs irrigué sont converties, pour moitié en céréales sèches et pour moitié en cultures irriguées (30% en blé, 10% en soja et 10% en céréales).
Garonne 2050 penche plutôt pour une limitation de la ressource dévolue au secteur agricole, avec une baisse des prélèvements de 50%. Résultat : une diminution de la surface agricole utile de 20%, une irrigation limitée aux produits à forte valeur ajoutée, accompagnée d'une disparition du maïs consommation, du soja et des pois irrigués. "Ce choix témoigne d'un tiraillement : la volonté de maintenir cette activité économique sur le territoire, tout en la contraignant à s'adapter (diminution des surfaces irriguées, changement de l'assolement) à travers un volume accordé plus faible que celui actuellement mobilisé".
Au final, estime le Cep, les conclusions et recommandations de ces trois études sont proches de celles inscrites dans le plan national d'adaptation au changement climatique (Pnacc), dont l'objectif est de réduire de 20% les volumes d'eau prélevés d'ici 2020 : trouver "un équilibre entre une logique d'accroissement de l'offre (optimisation de l'existant, substitution à travers les retenues) et une limitation de la demande (recherche d'efficience, sobriété)". Afin de trouver ce juste équilibre, les caractéristiques locales devront être prises en compte. "Ces différentes approches convergent donc aussi dans le sens du rapport Martin, qui entendait s'appuyer sur une vision partagée au plus près des territoires entre les différents usages en fonction des caractéristiques locales". Car, pour le Cep, "au-delà des efforts rendus nécessaires pour chaque secteur, ces études soulèvent aussi une question importante, celle des modes d'arbitrage et de conciliation entre les différents usages, et donc d'accès à l'eau".