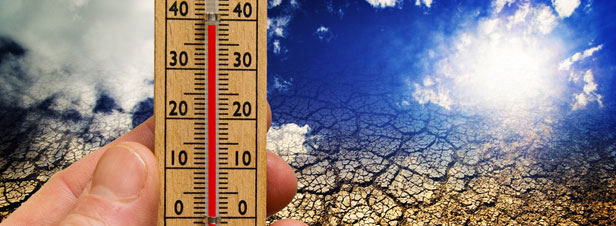Dans son deuxième volet remis fin mars, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) alertait sur les risques croissants liés aux changements climatiques et sur la nécessité d'agir pour limiter les impacts de ces dérèglements. Variabilité des rendements agricoles, risques d'inondation et de submersion marine, phénomènes accrus de sécheresse et perturbations des régimes pluviaux sont attendus dans les décennies à venir.
Dans le cadre de la mission d'information sur les conséquences géographiques, économiques et sociales du changement climatique, la commission développement durable de l'Assemblée nationale a organisé, le 16 avril, une table ronde dédiée à l'adaptation.
En France, un premier plan national d'adaptation au changement climatique (Pnacc) a été mis en œuvre sur la période 2011-2015. A mi-parcours, Nicolas Bériot, secrétaire général de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (Onerc), estime que le Pnacc "a amélioré la connaissance du changement climatique sur le territoire. Beaucoup d'actions ont en effet été menées pour développer la compréhension de ce phénomène". Si, au niveau national, de nombreuses études ont été lancées, les territoires ne sont pas en reste. Beaucoup de régions, à l'instar du Nord-Pas-de-Calais et de Rhône-Alpes, ont lancé leurs propres observatoires du climat et plans d'adaptation. La plupart d'entre elles ont identifié les priorités d'adaptation et les ont par ailleurs inscrites dans les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE).
Rhône-Alpes : des activités économiques "météo dépendantes"
La région Rhône-Alpes s'attend à une augmentation des températures et du risque de canicule, à une modification du régime des précipitations et à une diminution de la couverture neigeuse. Le territoire risque également de subir plus fréquemment et plus intensément des épisodes cévenols (1) . L'activité économique régionale pourrait être fortement impactée : "Notre PIB est très météo dépendant", analyse Jean-Philippe Deneuvy, directeur régional adjoint de l'environnement. "La ressource en eau est essentielle pour de nombreuses activités comme l'agriculture, la production d'électricité (barrages, nucléaire) ou le tourisme. Or, malgré l'abondance des ressources régionales, la moitié du territoire est en déficit ou en tension". La région et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse ont donc lancé un plan d'adaptation au changement climatique, qui se penche également sur la Corse et le Roussillon.
L'évaluation de la vulnérabilité du territoire (2) , confiée au climatologue Hervé le Treut, a par exemple révélé que le Rhône verrait son débit diminuer de 30% en saison estivale en 2050, faute de fonte de neiges de printemps.
Des priorités d'action ont donc été définies. Les économies d'eau dans tous les secteurs, encouragées par une tarification incitative, et l'augmentation de la performance des réseaux en font partie. Le développement de cultures moins gourmandes en eau et résistantes à la sécheresse est préconisé à moyen terme, tout comme la gestion multi-usages des ouvrages hydroélectriques et un aménagement limitant les effets de l'artificialisation (limitation de l'imperméabilisation, stockages temporaires de l'eau de pluie…).
Une attention particulière est également portée aux activités touristiques puisque la région compte 106 domaines skiables, dont 60 pourraient devenir vulnérables à terme car situés en deçà de 1.500 m d'altitude. La pertinence du recours à l'enneigement artificiel devra être étudiée pour chaque cas. La diversification des équipements touristiques est fortement encouragée.
Nord-Pas-de-Calais : des risques littoraux à la question urbaine
Le Nord-Pas-de-Calais a, de son côté, listé sept vulnérabilités au changement climatique : les risques de submersion marine et d'inondation continentale, accentués par l'élévation du niveau de la mer ; les vagues de chaleur, de sécheresse et de canicule et leurs impacts sur la population ; la diminution et la dégradation de la ressource en eau et enfin la vulnérabilité des forêts, des zones humides mais aussi des constructions (phénomènes de retrait et de gonflement de l'argile).
Par exemple, 90% des dunes et 25% des ouvrages en mer seraient en mauvais état et donc particulièrement vulnérables. 20.000 personnes se trouveraient ainsi menacées par un risque de submersion marine. Les ouvrages de protection appartiennent à 25 propriétaires différents, un travail de gouvernance devra donc être entrepris pour limiter les risques. Au total, la région a chiffré les travaux nécessaires entre 200 et 300 M€. "Ce qui est peu en comparaison du plan Delta initié par les Pays-Bas, qui se chiffre à 1 Md€ par an", analyse Michel Pascal, directeur régional de l'environnement.
La région a également identifié comme essentielle la lutte contre l'artificialisation des sols, "qui a explosé en dix ans, passant de 500 à 1.500 hectares par an". Avec une conséquence importante : la création d'îlots de chaleur urbains. Dans son SRCAE, le Nord-Pas-de-Calais a étudié les actions pour prévenir l'apparition de ces phénomènes. L'une des priorités : réintroduire la nature en ville pour augmenter le taux d'humidité de l'air, créer de l'ombre, purifier l'air (feuillage des arbres), gérer les eaux de ruissellement (racines) mais aussi réfléchir la lumière solaire. Une fiche technique recense les espèces à privilégier (charme commun, prunier épineux, saule marsault, sureau à grappes…) et les aménagements les plus efficaces. "L'aménagement d'un parc arboré de 100 m2 au cœur d'un îlot urbain, bordé par des immeubles de 15 mètres de hauteur, permet d'abaisser la température de 1°C dans les rues canyons adjacentes", peut-on y lire. La création d'un réseau de parcs arborés et d'une ceinture forestière et d'eau est préconisée. Une végétalisation des façades est également recommandée dans les lieux où l'espace au sol est limité.
Le projet Epicea, mené entre 2008 et 2012 par Météo-France et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) dans le cadre du programme de recherche Paris 2030, a abouti à des conclusions similaires. Il estimait que la modification des propriétés radiatives des façades et toitures des bâtiments (grâce à la couleur blanche), la végétalisation des espaces (3) et l'humidification des chaussées (grâce au réseau d'eau non potable) permettait de réduire la température de 1° à 2°C en moyenne lors d'un épisode caniculaire.