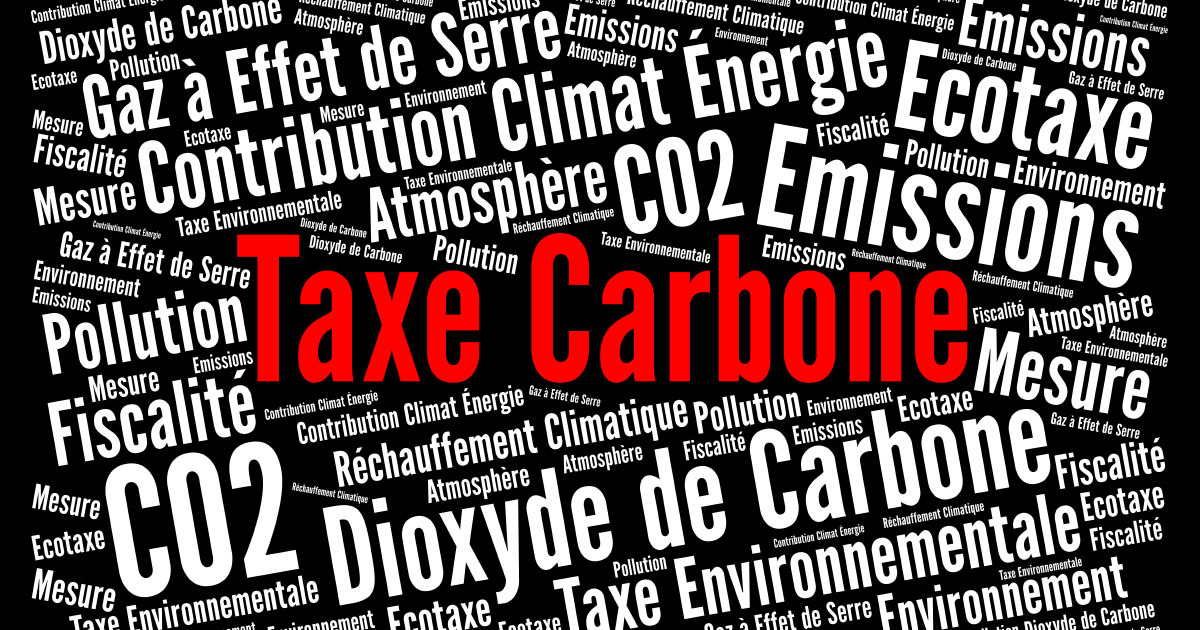Depuis la crise des Gilets jaunes de 2018, le concept de taxe carbone a tendance à donner des sueurs froides à la plupart des décideurs publics français. C'est donc à un immense tabou que s'attaque l'Agence de la transition écologique (Ademe), en publiant, cet été, sa note d'analyse « Pour un contrat social de transition. Propositions pour une réforme équitable de la valeur du carbone ». Une synthèse issue de multiples échanges menés, entre décembre 2020 et décembre 2021, avec plus de 200 chercheurs, parlementaires, collaborateurs des administrations et des ministères, membres de laboratoires d'idées et représentants de la société civile, complété d'un rapport technique (1) , lui-même publié en juillet 2021.
Au-delà de la nécessaire gestion de crise et des réponses immédiates, par ailleurs très onéreuses, « il est crucial d'accroître au plus vite les efforts de décarbonation de nos sociétés, pour prévenir et atténuer l'amplitude de chocs de toute nature, géopolitiques, économiques, écologiques », argumentent les analystes de l'Agence. Ces derniers soulignent l'importance de donner le bon « signal prix », en favorisant « une montée en puissance » des outils qui pénalisent les émissions de gaz à effet de serre : taxes, mais aussi normes et soutiens ciblés. « Il existe au niveau international un solide consensus académique sur cette question », assure l'Ademe. Or, s'il est difficile de mesurer précisément cette valeur, en France, elle reste, de toute façon, très en deçà du niveau requis pour prétendre atteindre la neutralité carbone en 2050.
Restaurer la confiance
Mais pour faire bouger les lignes, les obstacles sont nombreux : méfiance envers le gouvernement et les politiques publiques, fiscalité jugée opaque et injuste, manque de cohérence de l'instrument, efficacité environnementale pénalisée par des exonérations… Les recettes de la Contribution Climat Énergie ne financent par exemple aucun projet particulier et ne permettent pas d'en suivre précisément ses usages. Cette taxe carbone serait ainsi considérée, par 43 % des personnes interrogées en 2021 par les deux économistes Thomas Douenne et Adrien Fabre, comme un prétexte pour augmenter les impôts.
Privilégier l'équité
En parallèle, l'Agence de la transition écologique met aussi l'accent sur une indispensable équité en matière de répartition de l'effort. Dans ce domaine, ménages et entreprises ne sont, en effet, pas logés à la même enseigne. À l'origine d'une part importante des émissions carbone, de nombreux secteurs d'activité et produits fossiles bénéficient de taux réduits, de remboursements partiels, voire d'une exemption totale de fiscalité énergétique et/ou carbone. Une sortie progressive des régimes dérogatoires et autres « niches fiscales » devrait ainsi s'engager. Mais, même au sein des ménages, le poids de la fiscalité carbone se répartit inégalement entre les plus riches et les plus modestes, qui consacrent une part non négligeable de leur budget aux dépenses énergétiques. De préférence aux redistributions monétaires, des modalités d'accompagnement spécifique pourraient alors être définies afin de les aider à trouver des solutions alternatives : crédits d'impôts ou prêts à taux avantageux pour des travaux de rénovation thermique, primes à l'achat de véhicules propres, etc. En cas d'augmentation excessive du cours du pétrole et du gaz, un prix abordable devrait aussi leur être garanti pour leurs besoins de base en énergie.
Viser l'efficacité, mais aussi une autre gouvernance
La revalorisation de la valeur carbone ne doit toutefois pas mettre en péril l'équilibre économique du pays. Sans négliger les besoins de financement des services publics et de la protection sociale, les analystes de l'Ademe suggèrent donc également, après évaluation des différentes options, des baisses des prélèvements obligatoires sur les ménages et sur les entreprises, notamment ceux qui reposent sur leurs coûts de production. « Fixée au bon niveau, la valeur du carbone crée un environnement économique favorable à une action à la hauteur de l'enjeu, sans opter pour des choix trop coûteux », argumentent-ils.
Une définition de la valeur carbone
Les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur le bien-être des populations relèvent des externalités négatives générées par l'action des acteurs économiques (ménages, entreprises, collectivités, etc.), sans que ces derniers en supportent le coût. Le coût social de l'émission d'une tonne de CO2 est ainsi supérieur au coût privé payé par ces acteurs économiques pour réaliser leurs actions. Afin d'y remédier et d'inciter ces acteurs à réduire leurs émissions de CO2, une valeur économique doit y être associée.
Un nouveau contrat social
Pour les analystes de l'Ademe, la question de la valorisation du carbone ne se réduit pas à un choix d'instruments, taxe ou marché de quotas versus réglementations, subventions, obligations. Elle renvoie « à des enjeux plus larges de cohérence climatique des politiques publiques, d'efficacité et d'équité, donc à la construction de compromis politiques ». Autrement dit, à « la fondation d'un nouveau contrat social articulé à la question climatique ».
Des éléments qui pourront utilement alimenter la réflexion de l'exécutif, alors que se profile la préparation d'une loi de programmation énergie-climat, prévue pour 2023, d'où découleront les feuilles de route de la Stratégie nationale bas carbone et les plans d'adaptation au changement climatique.