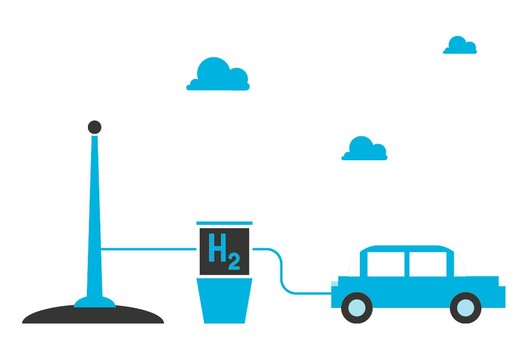L'incertitude relative au rôle futur du réseau électrique de distribution et à son financement est l'un des principaux enjeux du développement de l'autoconsommation de l'électricité photovoltaïque. Telle est l'une des conclusions qui ressort de la journée d'échanges organisée jeudi 10 avril par l'Office franco-allemand pour les énergies renouvelables (OFAEnR) et relative aux nouveaux modèles de consommation photovoltaïque.
Si Pierre Fontaine, sous-directeur des systèmes électriques et des énergies renouvelables au ministère de l'Ecologie, annonce "un développement spontané de l'autoconsommation avec la parité réseau", il rappelle cependant que les prix de production photovoltaïque ne le permettent pas encore en France. Cependant, le ministère "souhaite l'accompagner", et c'est dans cette optique qu'il a établi un groupe technique sur le sujet au sein duquel il semble bien que la question du financement du réseau électrique par les futurs autoconsommateurs tient une place de choix.
Comment entretenir le réseau de distribution si les producteurs photovoltaïques consomment leur production, se "coupent" du réseau et sont exemptés des taxes le finançant ? La question a été l'un des fils rouges des débats.
Premières pistes en juin
Pierre Fontaine a indiqué que le rapport du groupe de travail sur l'autoconsommation sera remis en juin.
Comment articuler les mesures proposées par le rapport avec la loi de transition énergétique dont la rédaction devrait être achevée en juin ? Pour l'instant, le représentant du ministère de l'Ecologie se contente de noter que certaines mesures pourraient être d'ordre règlementaire. Quant aux mesures d'ordre législatif, elles pourraient être introduites au Parlement au cours de la discussion de la loi de transition énergétique.
En Allemagne, l'autoconsommation s'est développée à partir de fin 2011, c'est-à-dire lorsque le coût de production de l'électricité photovoltaïque a chuté à un niveau inférieur au prix de l'électricité commercialisée. Une situation favorisée par le gouvernement allemand qui lui a donné un coup de pouce en exonérant les sites en autoconsommation des taxes de financement du réseau électrique et de la compensation dédiée au financement des énergies renouvelables.
En France, il semble que les pouvoirs publics hésitent à suivre une telle voie, tout du moins sans obtenir de contrepartie. Pierre Fontaine a ainsi expliqué que pour ErDF, qui gère le réseau de distribution français, l'autoconsommation est accueillie favorablement si elle permet d'alléger son travail. Pour cela, il faut que l'autoconsommation permette de réduire les "pics" et en particulier les pics d'injection liés aux énergies renouvelables. "C'est simple pour le tertiaire [la production photovoltaïque coïncidant avec "les heures de bureau", ndlr] mais le résidentiel nécessitera stockage et pédagogie", estime le représentant du ministère.
Autoconsommation n'est pas autarcie
Reste que, pour la plupart de ses promoteurs, l'objectif de l'autoconsommation n'est pas de simplifier la vie du gestionnaire de réseau… En poussant la logique d'ErDF à l'extrême, l'autoconsommation placerait le photovoltaïque hors réseau, ce qui résoudrait de fait le problème de gestion du déphasage entre la production photovoltaïque et la consommation électrique française. En creux, se cache donc la question du rôle du gestionnaire de réseau et de sa préparation face à la montée en puissance des moyens de production renouvelables décentralisés.
Quand les intervenants allemands rappellent qu'outre-Rhin de nombreux réseaux sont gérés par les communes et certains réseaux, en particulier en zones industrielles, fonctionnent même en circuit fermé, leurs homologues français expliquent que le réseau de distribution français appartient aux communes mais est géré par ErDF.
"ErDF a mis la main sur le réseau, alors qu'il appartient aux communes", déplore Marc Jedliczka, directeur général de l'association Hespul, qui juge que la transition énergétique doit placer la gestion du réseau entre les mains des communes pour favoriser les projets territoriaux et décentralisés.
Gérer des îlots
En l'occurrence, pour la plupart des intervenants, l'autoconsommation peut difficilement se passer du réseau pour être optimale. Ce dernier "est la batterie idéale", défend Marc Jedliczka. En effet, pour faire coïncider la courbe de production avec la consommation, il est plus judicieux de raisonner en "îlot". Ainsi, le photovoltaïque installé sur un bâtiment résidentiel pourrait alimenter un site commercial. Mais pour cela, il faut… un réseau.
Il est bien sûr possible de "conquérir le droit de ne pas utiliser le réseau public", comme le défend Luc de Marliave, membre du bureau du Syndicat des énergies renouvelables (SER). Néanmoins, pour nombre d'acteurs, le plus efficace serait d'adapter le réseau existant pour permettre le développement de projets locaux, à l'échelle d'un quartier par exemple, s'appuyant, entre autres, sur le photovoltaïque. L'idée est d'autant plus intéressante que le fonctionnement en îlot permet de ne pas tuer le gisement en sous-dimensionnant les installations faute de pouvoir consommer l'intégralité du potentiel photovoltaïque du bâtiment.
Mais un tel système fait de ces autoconsommateurs des "clandestins du réseau", selon certains détracteurs. "Non", répond Thierry Mueth, président du syndicat des professionnels de l'énergie solaire (Enerplan), expliquant qu'avec "ce changement de modèle, il faut changer de règles". En l'occurrence, le représentant d'Hespul plaide pour faire d'ErDF "un collecteur d'électricité", c'est-à-dire un acteur dont le rôle serait de prendre en charge les énergies décentralisées plutôt que d'acheminer l'électricité produite par des moyens centralisés.