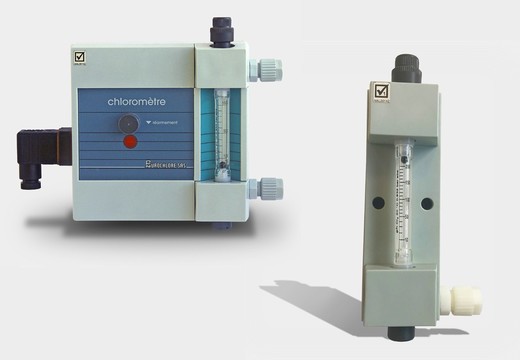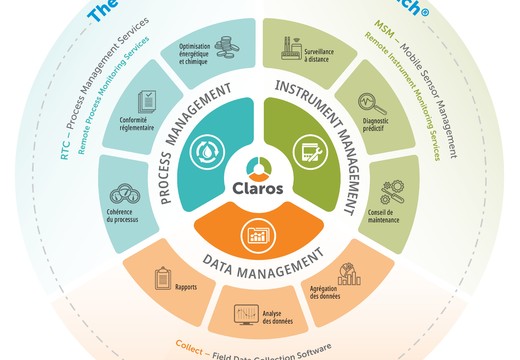La crise de la Covid-19 a montré l'importance d'intégrer les santés humaine, animale et environnementale au sein d'une même approche. Cette vision unifiée « One Health » est également capitale en matière de lutte contre l'antibiorésistance. « Nous pouvons considérer l'environnement comme un réservoir inépuisable de gènes de résistance », a ainsi pointé Didier Hocquet, microbiologiste clinique au CHU de Besançon, lors d'une journée (1) sur la contamination des milieux aquatiques par des substances pharmaceutiques, organisée par le pôle eau et territoires du Graie (2) et l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Car, bien avant l'utilisation massive des antibiotiques, les bactéries ont su se doter de mécanismes de résistance. Un groupe de chercheurs a ainsi récemment constaté que la présence d'un champignon producteur d'un antibiotique – la méthicilline - sur la peau des hérissons (3) avait ouvert la voie à des bactéries résistantes à ce dernier. Les micro-organismes insensibles à la méthicilline passant ensuite aux vaches et aux animaux domestiques, puis à l'homme.
Aujourd'hui, le contexte de forte demande d'antibiotiques – notamment en France – a créé un environnement particulièrement favorable à l'apparition d'antibiorésistances. Et a provoqué une pollution (4) de l'environnement. Le lien est en effet très fort entre la consommation de médicaments et leur présence dans le milieu. « Une étude régionale de l'agence de l'eau Seine-Normandie a montré, par exemple, que la part de la quantité de médicaments vendus retrouvée dans la Seine peut atteindre 15 % pour la clarithromycine, sans compter les métabolites », a notamment indiqué Pierre-François Staub, chargé de mission pollution des écosystèmes et métrologie à l'Office français de la biodiversité (OFB). Car si les stations d'épuration traitent bien une partie des médicaments, elles en laissent également sortir certains. Des projets de recherche (5) se sont ainsi intéressés à la contamination pharmaceutique dans les milieux. Ils montrent que certains résidus sont bien abattus lors de leur passage dans une station d'épuration, comme l'aspirine ou le paracétamol. Mais d'autres échappent au traitement, dont des antibiotiques (6) comme la ciprofloxacine.
Une contamination pharmaceutique généralisée
Et désormais, la contamination pharmaceutique des milieux aquatiques est un problème mondial. « Dans la récente étude internationale de Wilkinson et al., seuls quatre bassins sur 137 – en Amazonie, en Islande, et Norvège – sont exempts des 61 résidus de médicaments recherchés, a indiqué Pierre-François Staub. Les trois bassins français de cette étude – dont la Seine, à Paris – sont situés un peu en dessous de la médiane mondiale en termes de pollution cumulée. » Selon ces travaux, dans près d'un quart des sites surveillés, les concentrations de médicaments présents dans les rivières dépasseraient les niveaux recommandés pour préserver la biodiversité aquatique ou se prémunir des phénomènes d'antibiorésistance.
Ce dernier point reste toutefois mal appréhendé. Des scientifiques s'efforcent donc de mieux comprendre les mécanismes mis en œuvre dans l'environnement et qui jouent un rôle dans l'apparition et la diffusion des résistances bactériennes dans un contexte européen. Les projets Sipibel et Pandore, par exemple, utilisent des biofilms comme sentinelles et évaluent l'acquisition d'antibiorésistance par les bactéries. « Les biofilms sont constitués d'une communauté bactérienne qui vit ensemble et coopère plus ou moins. Ils adhèrent à des plantes, des rochers », a précisé Jérôme Labanowski, chargé de recherche CNRS dans l'équipe E-Bicom (eaux, biomarqueurs, contaminants organiques, milieux). Les scientifiques ont recherché des antibiotiques dans les biofilms prélevés dans la rivière Arve (Haute-Savoie), dans l'Orge (au sud de Paris) et dans le Clain (Poitiers), en amont et en aval de stations d'épuration. « En conclusion, de nombreux antibiotiques sont largement présents, quelle que soit la période. Toutefois, la contamination est plus importante au plus près des sources de rejets, a exposé Jérôme Labanowski. Nous avons voulu relier l'imprégnation des biofilms à la prescription de médicaments grâce à des données de l'assurance maladie, mais les tendances ne se superposent pas. »
Les chercheurs ont alors essayé de savoir si les concentrations retrouvées étaient suffisamment élevées pour permettre la sélection et le développement de bactéries résistantes aux antibiotiques. « En amont des stations d'épuration, en théorie, nous pourrions penser que les niveaux de concentrations n'entraînent pas de sélection. Mais pour certains antibiotiques, nous nous sommes rendus compte que c'était le cas, par exemple la Lévofloxacine, a détaillé Jérôme Labanowski. En aval, la concentration qui provoque la sélection est présente plusieurs mois au cours de l'année. Ce qui alerte sur le risque. » Les antibiotiques plus particulièrement concernés sont ceux de la classe des fluoroquinolones (lévofloxacine et ciproflaxine) et des macrolides (azithromycine et clarithromycine).
Des situations d'exposition limitées en Europe
« Toutefois, dans les milieux occidentaux, nos contacts avec un environnement ou une situation extrême d'exposition majeure sont limités, a souligné Didier Hocquet, microbiologiste clinique au CHU de Besançon. Quand une bactérie résistante est relarguée dans l'environnement, par exemple E. coli résistante à des antibiotiques de dernière génération, elle survit peu dans l'environnement : sa concentration à 3 ou 5 km en aval d'une station d'épuration est équivalente à celle en amont (7) . Dans l'eau souterraine, nous n'en retrouvons quasiment jamais. »
Des scientifiques se sont aussi intéressés au risque de contamination humaine par des bactéries résistantes présentes dans l'environnement en analysant des échantillons d'eau de baignade, en Angleterre et au Pays de Galles. Ils ont, dans le même temps, estimé les risques d'ingestion d'eau et réalisé une étude épidémiologique sur des baigneurs et des surfeurs. Leurs conclusions : par rapport au reste de la population, les surfeurs anglais (8) seraient quatre fois plus contaminés par des bactéries E. coli résistantes. Cette transmission resterait toutefois faible. « Dans les pays occidentaux, les trois quarts des E. coli résistantes aux céphalosporines de troisième génération qui nous parviennent viennent de transmission interhumaine ou par l'intermédiaire des animaux de compagnie », a illustré Didier Hocquet.
Connaître les niveaux de résistance par pays
Un outil européen interactif permet de connaître les niveaux de résistance de neuf bactéries à vingt antibiotiques chez les humains et chez certains animaux indicateurs (ou aliments), pays par pays, en 2019 et 2020. Il montre par exemple, qu'en France, un type de bactérie, à l'origine d'infection alimentaire, Salmonella Kentucky, présente des résistances à plusieurs antibiotiques, notamment à un niveau « extrêmement élevé » (supérieur à 70 % des bactéries signalées) pour l'ampicilline, la ciprofloxacine, la tétracycline, le sulfaméthoxazole et l'acide nalidixique.
Des « hot spot » d'antibiorésistance à cibler
Les conditions qui favorisent l'émergence de bactéries résistantes sont bien connues : un milieu pollué par des agents de sélection comme les antibiotiques où se côtoient des bactéries pathogènes et des bactéries « autochtones ». Par exemple, une rivière qui recevrait des effluents d'une industrie pharmaceutique productrice d'antibiotiques, mais également de la station d'épuration ou directement des effluents rejetés sans traitement. Si le site sert dans le même temps de lieu de baignade, le risque de contamination à l'homme augmente. « Nous avons majoritairement confié notre production d'antibiotiques à la Chine et l'Inde, où les stations d'épuration ne sont pas au même niveau de normes qu'en Europe, a rappelé Didier Hocquet. Or un problème de santé publique qui émerge en Chine ou en Inde devient universel quelque temps plus tard. » Une réalité que la crise de la Covid-19 a récemment mis dans toutes les mémoires.
« Il ne faut pas attendre d'avoir toutes les réponses pour commencer à travailler, a donc estimé Didier Hocquet. Le traitement des eaux usées est une priorité dans les pays à bas revenus et intermédiaires (10) . Il faut favoriser l'usage d'antibiotiques qui se dégradent vite, mais aussi travailler sur la maîtrise des rejets des industries pharmaceutiques. »
Et les résidus de médicaments restent une pollution légale… Ceci dans un contexte de consommation en hausse et d'un environnement hydrique sous tension en raison du réchauffement climatique (étiage des cours d'eau, déversoir d'orage, etc.). Si le monde de la science continue à engranger des connaissances, les efforts de réduction de cette pollution, en revanche, progressent à très petits pas. Et les scientifiques s'interrogent sur la réelle prise en compte de leurs résultats et sur la façon d'améliorer les modalités pour son transfert. « De nombreuses connaissances ont désormais été accumulées (constats et méthodes), qu'il faut convertir en actions dans un cadre intégré de gestion, depuis la mise sur le marché jusqu'au traitement, en considérant tous les compartiments écologiques concernés », a interpelé Pierre-François Staub.