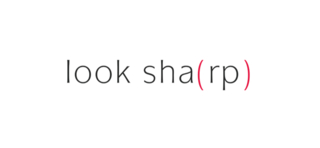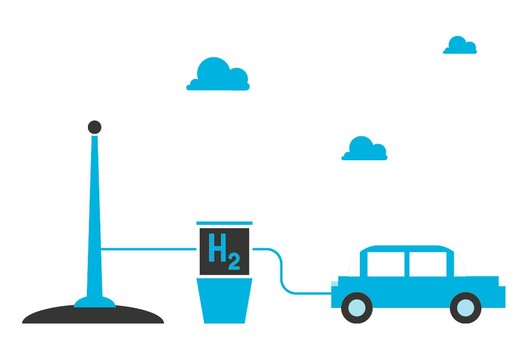Le 22 février, vingt-quatre heures après les déclarations initiales de Vladimir Poutine et quarante-huit heures avant l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le chancelier allemand, Olaf Scholz, décide de suspendre l'homologation du gazoduc Nord Stream 2, censé alimenter l'Allemagne en gaz naturel en provenance de Russie. Le 8 mars, la Commission européenne présente son plan REPowerEU visant à s'émanciper totalement du gaz russe avant 2030. Elle compte même sur la réduction de deux tiers des importations d'ici à la fin de l'année 2022. Un désir d'indépendance dont le gouvernement français partage l'ambition et souligne « l'urgence absolue ».
Que faire alors pour réussir cette émancipation sans pérenniser, par exemple, un éventuel recours au gaz de schiste américain ? Comment parvenir à se saisir de cette malheureuse opportunité pour continuer de décarboner notre consommation de gaz ? En 2021, 99 % des 475 térawattheures (TWh) de gaz naturel consommé annuellement en France résultaient d'importations : 70 TWh (soit environ 15 %) étaient d'origine russe. Du reste, la production nationale de gaz reposait déjà essentiellement sur le biométhane (4,3 TWh injecté dans le réseau), le seul dans le champ des gaz verts dont la technologie est opérationnelle et comporte un modèle économique. La filière du biométhane peut cependant miser sur un jeu de leviers pour remplacer, à terme, l'import russe.
Libérer 15 TWh/an de plus d'ici à 2024
À la fin de l'année 2021, la capacité de production maximale de biométhane (6,4 TWh) a dépassé l'objectif fixé par la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), avec deux ans d'avance. De plus, l'équivalent de 19 TWh d'installations additionnelles se trouve encore dans les registres de capacité. Plus fort encore, cette performance a été réalisée après la révision tarifaire imposée depuis la fin de l'année 2019, qui avait pourtant mis un véritable coup d'arrêt au développement de la filière. « Ce manque de visibilité provoquée par l'État, avec la baisse forcée du tarif et un faible volume cible à atteindre, a poussé certains constructeurs et équipementiers à ne pas investir, rappelle Simon Métivier, expert en gaz renouvelables de l'association Solagro. À l'époque, le prix du biométhane était plus élevé que celui du gaz naturel, mais aujourd'hui la situation s'est inversée. » Avec un prix fixe compris entre 50 et 90 euros le mégawattheure (€/MWh), le biométhane s'avère désormais être une solution plus économique que le gaz naturel, dont le prix a explosé et avoisine actuellement les 135 €/MWh.
Quelles conditions faut-il donc réunir pour en profiter et donner un nouveau coup de fouet à la filière ? Ses représentants, réunis à Paris, le 17 mars, pour dresser leur bilan annuel (1) , ont donné leurs réponses. En premier lieu, ils appellent l'État, d'une part, à raccourcir les délais d'obtention des autorisations et, d'autre part, à étendre le délai de mise en service de trois ans au-delà duquel l'exploitant ne peut plus bénéficier du même niveau de tarif d'achat. Ils souhaitent également que soit instaurée la garantie d'un tarif d'achat fixe pour récompenser l'éventuelle production additionnelle dépassant la capacité maximale autorisée, afin de réaliser le plein potentiel des unités existantes.
Ces mesures, si elles sont prises « immédiatement », serviront « à débrider » la filière, selon Laurence Poirier-Dietz, directrice générale du gestionnaire de réseau de distribution, GRDF. « Si l'État fait accélérer l'instruction des dossiers en file d'attente par ses services et garantit un dispositif de soutien stable, nous connaîtrons une forte accélération du nombre de nouveaux projets », affirme, quant à lui, Jean-Louis Bal, le président du Syndicat des énergies renouvelables (SER). Ce dernier estime que ces leviers pourront libérer une capacité additionnelle de 15 TWh/an d'ici à 2024 et permettront ainsi de dépasser la fourchette basse de l'objectif 2028 de la PPE (14 TWh).
D'autres actions seront néanmoins nécessaires pour satisfaire la demande par d'autres moyens que les importations de gaz russe. À cet égard, la filière demande le lancement de plusieurs dispositifs de soutien : les appels d'offres inscrits dans la PPE pour les installations de plus de 25 GWh/an, des appels à projets pour développer l'innovation et convertir la mobilité lourde au bioGNV, ainsi que les certificats de production de biogaz (CPB), prévus par la loi Climat et résilience. Ces derniers « seront un cadre de référence pour installer la filière dans la durée, à la fois au regard de la production et de la demande », énonce la directrice de GRDF. Très attendus par les professionnels, les CPB devraient être mis en place par un premier décret, « publié avant la fin du mois de mars » selon Laurence Poirier-Dietz, et un second fixant les taux d'obligation d'incorporation pour les fournisseurs à partir de 2023. Ce dernier est également espéré « cette année et le plus tôt possible » par Anthony Massenga, directeur gaz renouvelables et hydrogène de GRTgaz.
Placer le biométhane au premier plan
Ainsi armée (sans oublier le récent arrêté augmentant le taux de prise en charge par l'État du coût de raccordement), la filière affirme pouvoir raccorder 70 TWh/an de capacité d'ici à 2030, satisfaire l'ambition du plan REPowerEu de doubler l'objectif de production de son paquet Fit-for-55 et se substituer aux imports de gaz russe. L'ensemble des acteurs milite cependant pour aller encore plus loin, « pour que le biométhane soit considéré au même titre que l'éolien et le solaire », dans la vision stratégique à long terme de l'État, réclame Julien Tchernia, cofondateur et P-DG d'ekWateur, fournisseur de gaz qui ne propose plus que des offres 100 % biométhane depuis le début de la guerre en Ukraine. « À entendre le discours d'Emmanuel Macron à Belfort, le biogaz semble absent du mix énergétique futur. »
Autre avantage : la méthanisation peut se substituer au gaz fossile pour produire des engrais de synthèse, en plus de fournir des digestats exploitables eux-mêmes comme engrais. Transformé en carburant (BioGNV), le biométhane peut également participer au verdissement de la mobilité lourde et du fret ferroviaire ou maritime, sans modifier la dimension des véhicules (l'équipement de batteries, en revanche, réduit la taille des véhicules et donc leur capacité maximale de transport).
En somme, accélérer le développement du biométhane – et plus largement, des gaz renouvelables – relève davantage « d'un intérêt général » que d'une simple solution d'urgence stratégique et « dépasse le seul enjeu énergétique, mais aussi agronomique », affirme Alexis Monteil-Gutel, expert en énergies renouvelables du réseau Cler. Toute la filière semble partager ce point de vue et miser sur le début des débats pour l'élaboration de la prochaine PPE, en juin prochain, pour la matérialiser. Et Cécile Frédéricq, déléguée générale du syndicat France gaz renouvelables, de conclure : « Il ne faut pas seulement se contenter d'y inscrire des objectifs plus ambitieux, il faut aussi y inclure les moyens pour les accompagner et les atteindre. »