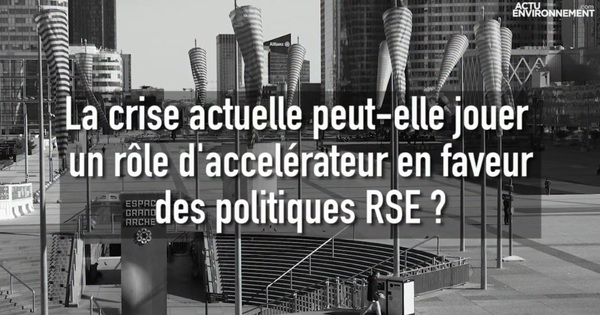L'encadrement et la régulation de la publicité font partie des gros enjeux du projet de loi climat que les députés examinent dans l'hémicycle depuis le 29 mars. Ces derniers ont adopté plusieurs amendements (1) lors de la séance du 1er avril en vue de lutter contre le greenwashing, ou écoblanchiment. Mais, dans le même temps, ils ont refusé d'encadrer juridiquement les engagements volontaires des entreprises en matière de publicité, que le texte promeut par ailleurs.
Renforcer les sanctions pénales
Le code la consommation prévoit déjà de sanctionner pénalement les pratiques commerciales trompeuses. Mais les députés ont adopté un amendement qui permet de renforcer les sanctions lorsque cette tromperie porte sur des arguments environnementaux. « La personne qui se rendra coupable de blanchiment écologique par le biais de la publicité se verra ainsi appliquer une sanction pécuniaire renforcée par rapport à ce que prévoyait déjà le code de la consommation au titre des pratiques commerciales trompeuses, et elle aura en outre l'obligation d'afficher la condamnation dont elle a fait l'objet », a expliqué la rapporteure Aurore Bergé, auteure de l'amendement.
Le texte voté prévoit que le montant de l'amende pourra être porté à 80 % des dépenses engagées pour réaliser la publicité trompeuse. La sanction prononcée fera l'objet d'un affichage ou d'une diffusion publique systématique. L'entreprise condamnée devra aussi afficher cette sanction sur son site internet. « C'est une grande avancée pour le droit de l'environnement et de la consommation », salue l'avocat et professeur de droit Arnaud Gossement sur Twitter.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement des députés Modem qui interdit la publicité pour des biens et services qui se prétendent « neutres en carbone ». « Une allégation qui ne trouve aucun fondement scientifique », estiment les auteurs de l'amendement. L'Ademe vient opportunément de le rappeler dans un avis publié le même jour que ce vote. « La neutralité carbone est une notion qui ne peut être définie qu'à l'échelle de la planète ou d'un État. (…) C'est pourquoi les acteurs ne peuvent ni devenir ni se revendiquer neutres en carbone individuellement à leur seule échelle », affirme l'Ademe.
La représentation nationale a également adopté un amendement de la rapporteure Aurore Bergé qui vise à renforcer l'information du consommateur dans la publicité en faveur des produits soumis à affichage environnemental. « Si nous créons un affichage environnemental, c'est parce que nous estimons que les consommateurs doivent être éclairés dans leurs choix, et cet affichage doit donc figurer dans la publicité », a expliqué la députée LReM.
Timides amendements sur la transparence
Mais si la majorité a pris des dispositions pour combattre le greenwashing et améliorer l'information des consommateurs, elle n'a adopté que de timides amendements pour encadrer les codes de bonne conduite en matière de publicité prévus dans le projet de loi. Ces engagements volontaires, signés sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), visent à réduire les publicités pour des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement. « Lors d'un point d'étape [de la mission confiée à Arnaud Leroy et Agathe Bousquet] organisé la semaine dernière, nous avons constaté que des filières structurantes pour le secteur de la publicité avaient d'ores et déjà formalisé des premiers engagements prometteurs », a expliqué la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
« Du droit bavard », estime, quant à lui, Arnaud Gossement. « En l'état, disons-le clairement : ces codes de bonne conduite (ou "contrat climat") pour la publicité n'engageront véritablement personne. Les premières victimes : les entreprises qui souhaitent vraiment s'engager pour l'environnement », déplore le professeur de droit, en charge d'une mission sur les engagements volontaires dans le domaine de l'environnement.
Engagements volontaires attaqués en justice
Car la majorité a rejeté deux amendements identiques portés par les députés Modem Erwan Balanant et LReM Véronique Riotton qui visaient à encadrer véritablement ces codes de bonne conduite et à éviter le greenwashing. « Nous constatons que certains engagements volontaires sont actuellement attaqués en justice en raison de leur caractère imprécis. Je pense aux engagements relatifs à l'épandage de pesticides à proximité des habitations (…). Avec de vrais engagements volontaires définis juridiquement, nous n'aurions pas eu ce problème (…). La confiance n'exclut pas le contrôle », a vainement plaidé le député Modem.
« Nous avons renforcé les outils de transparence, de mesure et de contrôle avec le rôle de l'Ademe et du CSA », a répondu la rapporteure Aurore Bergé. « Il est juridiquement compliqué de dire que des engagements volontaires doivent avoir un cadre clairement défini puisqu'ils sont justement volontaires », a ajouté la députée avant de donner un avis défavorable. « Je partage avec vous la volonté de crédibiliser les engagements volontaires visant la protection de l'environnement et de garantir que la signature de l'État engage des contreparties pour les autres signataires », a répondu Barbara Pompili aux auteurs des amendements. Mais la ministre a pourtant donné, elle aussi, un avis défavorable en arguant de fragilités juridiques.
Ces amendements avaient pourtant pour objet de « faire en sorte que l'État n'encourage plus le greenwashing en signant de vrais/faux contrats d'engagements », regrette Arnaud Gossement. « Si le contrôle de l'exécution des contrats climat n'est pas garanti en amont, c'est vers le juge que se tourneront à juste titre les associations de défense de l'environnement et des consommateurs en cas de manquement des annonceurs à leurs engagements », avait averti le professeur dans une chronique publiée sur Actu-Environnement avec la maître de conférences en droit Meryem Deffairi.