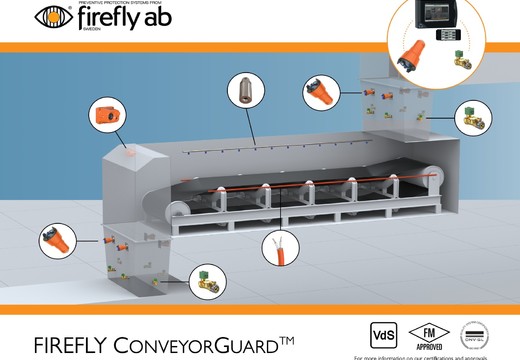Enseignant, co-fondateur du Printemps écologique
Actu-Environnement : En quoi la fédération que vous mettez en place se distingue-t-elle des syndicats traditionnels ?
Maxime Blondeau : Nous sommes la première union de syndicats à ne pas traiter l'impératif écologique comme une externalité mais comme une raison d'être. Nous sommes également les premiers à mettre en cause le productivisme. Avec les syndicats traditionnels, il est encore difficile de parler de décroissance sélective ou de démantèlement progressif de certaines filières polluantes. Une autre différence de fond vient du fait que nous portons un discours sur l'impact direct des entreprises sur la société, alors que la vocation des syndicats consistait surtout à défendre les intérêts de leurs membres face à leur employeur. Nous incarnons un élargissement du champ d'action syndical. De façon générale, nous proposons de repenser le travail de telle sorte qu'il soit respectueux du vivant, qu'il soit conçu comme une contribution sociale et qu'il contribue à une économie inclusive et régénérative.
AE : À qui s'adresse votre syndicat ?
M. B. : Nous pensons que la question écologique peut rassembler toutes les catégories socio-professionnelles dans un projet de société commun. Notre cible principale, ce sont les 93 % de salariés qui ne sont pas syndiqués et, pour les autres, nous encourageons la double adhésion. Notre but consiste à revitaliser le dialogue social en stimulant l'engagement des salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise. Dans les PME, il y a encore très peu de présence syndicale. Dans les seuls secteurs du conseil et du numérique, cela représente un potentiel de 1,2 million de salariés. Pourtant, la question de l'empreinte écologique du numérique devient un enjeu mondial, comme en témoignent les mouvements syndicaux chez Google, Facebook ou Amazon Employees for Climate Justice en Californie. Dans les grandes entreprises, comme celles du CAC 40 ou du SBF 120, nous allons développer des approches méthodologiques différentes des PME. Nous allons nous adresser aux communautés écosensibles préexistantes, dont certaines ont déjà obtenu des résultats via des stratégies RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Nous devons réinventer un mouvement depuis la base. Au XIXe, le syndicalisme ne s'est pas construit de façon centralisée.
AE : Quelle organisation souhaitez-vous mettre en place et comment la financez-vous ?
M. B. : Nous avons une volonté de simplicité, de transparence et d'agilité. À la différence des confédérations syndicales historiques, nous prévoyons une organisation à trois niveaux : les communautés syndicales sur le lieu de travail ; un deuxième niveau constitué de 26 syndicats dans les différentes branches professionnelles ; et, enfin, la fédération qui aura la compétence financière et médiatique. Pour l'instant, nous sommes financés à 100 % par les adhésions de nos membres et donateurs. Nous travaillons à une stratégie de financement par des fondations œuvrant dans le domaine du climat et de l'environnement, et par des réponses à des appels d'offres de l'Union européenne.
AE : Comment souhaitez-vous peser au quotidien dans les entreprises ?
M. B. : Il faut d'abord faire élire des représentants syndicaux. Nous allons prendre de l'expérience lors des premières élections professionnelles qui redémarrent en septembre 2020. Mais le grand rendez-vous aura lieu en 2022-2023 avec les élections dans la fonction publique et des grandes sociétés du CAC 40. Ensuite, nos représentants vont construire leur appareil revendicatif en s'appuyant sur des ONG partenaires dont l'expertise sera mise au service des salariés. À titre d'exemple, les salariés engagés pourront faire appel à HOP sur la question de l'obsolescence programmée, Zero Waste sur la gestion des déchets, le Réseau Action Climat (RAC) pour la question climatique, ou encore Tech4Life pour la comptabilité alternative. Notre levier principal, in fine, ce sera l'accord d'entreprise et la convention collective.
AE : Quels sont vos principaux axes d'action en matière d'environnement ?
M. B. : Nous avons identifié six axes, qui sont encore susceptibles d'évoluer. D'abord les pratiques individuelles sur le lieu de travail, les écogestes collectifs, portant, par exemple, sur la gestion des déchets, l'alimentation ou la mobilité. Nous souhaitons ensuite anticiper les mutations de l'emploi et accompagner la transition professionnelle des travailleurs, comme par exemple, dans le cadre du démantèlement ou du désinvestissement de certaines filières polluantes. Nous voulons lever le tabou de la casse sociale liée au désastre écologique. Il s'agira aussi d'adapter le mode de gouvernance à l'impératif écologique à travers des leviers structurels tels que la comptabilité ou la rémunération de l'actionnariat. Nous souhaitons aussi peser collectivement sur les choix technologiques. Il ne peut pas y avoir de découplage entre la technologie et l'écologie. Ainsi, dans le domaine des télécoms, des salariés s'interrogent déjà sur l'impact écologique de la technologie 5G. Plus classiquement, nous souhaitons imposer des objectifs climatiques aux entreprises à travers des indicateurs chiffrés. Et enfin, il s'agira d'adapter la loi aux enjeux du siècle. On peut, par exemple, envisager un élargissement du droit de retrait sur le modèle du droit de refus canadien permettant de s'opposer à la fracturation hydraulique. Mais, surtout, il s'agira d'inscrire les enjeux environnementaux dans le texte central qui régit les relations et les activités professionnelles : le code du travail.
AE : La crise actuelle vous conforte-t-elle dans votre initiative ?
M. B. : Oui, le Covid-19 est un accélérateur du changement. En 1946, la France, dévastée, a instauré une politique de solidarité jamais vue en créant la Sécurité sociale. L'histoire nous montre que c'est en se relevant des crises que l'on crée de grandes choses. Certaines filières liées au transport, dans l'aéronautique ou l'automobile, sont déjà en danger de mort. La contraction de la croissance et des échanges mondiaux impose une relocalisation d'un grand nombre d'activités. Et, dans le même temps, lors du déconfinement, on a constaté que certains droits des travailleurs n'ont pas été respectés. Les lobbies assument plus ou moins au grand jour leurs priorités sur les questions environnementales. C'est donc un moment-clé et la question du travail doit redevenir centrale pour réconcilier l'impératif écologique et la justice sociale.