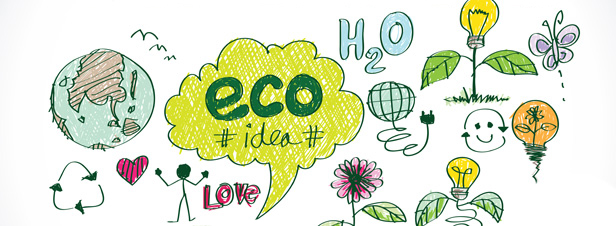L'avant-projet de stratégie nationale de la transition écologique vers un développement durable (1) (SNTEDD), élaborée dans le cadre du Conseil national de la transition écologique, a été mis en consultation (2) par le ministère de l'Ecologie ce 20 mars, jusqu'au 20 avril. Il identifie, pour les six années à venir (2014-2020), quatre enjeux prioritaires (le changement climatique, la perte de biodiversité, la rareté des ressources et les risques sanitaires environnementaux) et propose des orientations et des priorités d'actions.
"Il est à présent indispensable d'engager, au-delà d'une correction à la marge des trajectoires actuelles, une transformation d'ampleur de l'économie et de la société pour répondre à ces enjeux et aux impacts économiques et sociaux qu'ils engendrent", souligne l'avant-projet en préambule. Des indicateurs de suivi, en cours de définition, devraient être adossés à cette stratégie afin de mesurer les progrès accomplis.
Il faut "changer d'échelle en dépassant le stade de la prise de conscience, des initiatives pionnières, des bonnes pratiques et des premières mesures sectorielles, pour aller vers une mise en mouvement coordonnée de l'ensemble des acteurs de la société et secteurs de l'économie". Cela passe par un nouveau modèle économique et social, "qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble". La SNTEDD mise sur l'innovation technologique et sociale afin de "sortir d'un choix binaire entre modèle de croissance et modèle de décroissance pour s'intéresser plutôt au contenu qualitatif de la croissance". Les investissements publics et privés seront sollicités pour suivre cette trajectoire et envoyer les bons signaux.
Des territoires en transition
Tout d'abord, la stratégie insiste sur la nécessaire "solidarité écologique" des territoires, qui devrait d'ailleurs être inscrite dans le projet de loi cadre sur la biodiversité. Ce principe permet "de prendre en compte les interdépendances [en ressources] en appréhendant différemment la façon de gérer l'espace pour lutter contre la fragmentation de l'espace naturel et des espaces urbanisés". Elle met l'accent sur la prévention, plutôt que la réparation, qui est généralement plus coûteuse et techniquement difficile à mettre en œuvre.
Pour cela, un régime de protection des espaces naturels remarquables ou ordinaires sera mis en place, le développement des trames vertes et bleues sera accéléré. La lutte contre l'artificialisation des sols devra être renforcée, en s'appuyant notamment sur le cadre juridique prévu dans la loi Alur. Les territoires devront également être engagés dans la transition agro-écologique, en l'articulant avec la lutte contre les pollutions de l'eau, qui sont notamment d'origine agricole. De leur côté, les villes devront être plus sobres en ressources (3) , plus équitables et plus agréables à vivre.
Face aux risques naturels, technologiques ou sanitaires, la stratégie estime que "la résilience territoriale s'impose comme le moyen de dépasser les situations de crise et d'engager les territoires dans une vision à plus long terme". Cela passe notamment par l'identification et la valorisation des potentialités des territoires et une plus grande responsabilité des acteurs et des citoyens grâce au développement d'une culture du risque. La lutte contre la vulnérabilité énergétique, climatique et les inégalités en santé environnement (20770) constitue également une priorité de la stratégie.
"Le développement de territoires durables et résilients ne pourra être opérationnel qu'en recourant à des projets de territoires globaux et cohérents, qui font intervenir en synergie les acteurs, les outils et les politiques sectorielles à mobiliser". Diagnostic initial partagé, stratégie de territoire, gouvernance multi-acteurs et mesures de suivi sont préconisés. L'Etat doit quant à lui jouer un rôle d'animation de réseaux de projets de territoires "afin de favoriser leurs interconnexions, d'échanger les meilleures pratiques, de monter en capacité collective et d'encourager leur amélioration progressive".
Une économie en transition
L'économie circulaire devra être développée, en réorientant les modèles de production (éco-conception, REP, lutte contre l'obsolescence programmée…), d'échange (mutualisation des biens et services, économie de fonctionnalité …) et de consommation (affichage environnementale, réemploi…). "Toutes ces activités seraient favorisées si le prix des ressources reflétait davantage les impacts environnementaux liés à leur utilisation et leur rareté, incitant ainsi les acteurs économiques à les économiser. Par ailleurs, le développement de nouveaux modèles basés sur la performance est à étudier", souligne la stratégie. La fiscalité écologique est une des solutions pour envoyer le bon signal prix. "Par exemple, la mise en place d'une taxation des émissions polluantes et des consommations de ressources naturelles, à l'instar de l'introduction depuis 2014 d'une composante carbone dans la fiscalité des carburants, conduira à infléchir le comportement de chaque acteur économique qui arbitre entre payer la taxe et polluer ou réduire sa pollution pour payer moins de taxe".
L'économie circulaire passe aussi par la substitution de matières premières vierges par des matières premières issues du recyclage (4) , la réutilisation des eaux usées, la substitution de l'azote minéral par des effluents animaux, la mise en place d'une véritable écologie industrielle au niveau des territoires… L'ensemble de ces efforts doit être accompagné par des innovations technologiques.
Les pouvoirs publics doivent, via la réglementation, les politiques et les projets d'investissements, envoyer des signaux clairs et sur le long terme pour l'économie. Une programmation pluriannuelle de la transition écologique pourrait permettre cette lisibilité. "Par analogie à la responsabilité sociale et environnementale exigée pour les entreprises, une responsabilité sociétale institutionnelle, soit une responsabilité fiduciaire élargie aux enjeux portés par la transition écologique, devra être mise en place pour les investisseurs et financeurs publics...". Les produits financiers devraient également être fléchés vers la transition écologique, au moyen de l'instauration d'une éco-conditionnalité des avantages fiscaux attachés aux produits d'épargne longue et une traçabilité des investissements.
Toutes ces évolutions devront être conduites dans la concertation et le dialogue, afin d'éviter les résistances au changement. "La réussite de la mise en œuvre de nouveaux modèles économiques et financiers impose donc une organisation de leur gouvernance et un accompagnement ciblé des différentes catégories d'acteurs concernés". Les mutations professionnelles liées à la transition écologique devront être particulièrement prises en compte.