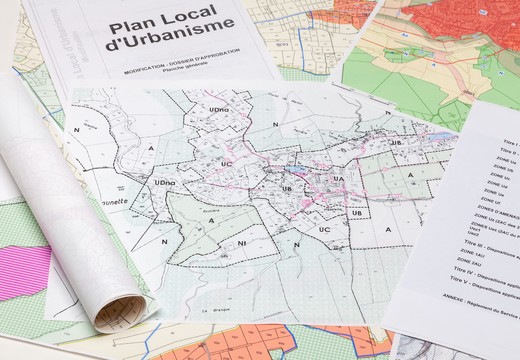Députée LReM du Var - Chargée de mission par le Premier ministre
Actu-Environnement : Pourquoi le Premier ministre vous a confié cette mission ?
Cécile Muschotti : L'idée de créer un Défenseur de l'environnement ressort des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est aussi un sujet sur lequel je travaille depuis plus de deux ans. J'avais émis l'idée de le créer sur le même modèle que le Défenseur des droits. C'est à partir de là que le président de la République a demandé au Premier ministre de me confier cette mission.
AE : Votre proposition correspond-elle à celle de la Convention citoyenne pour le climat ?
CM : On se rejoint sur beaucoup d'aspects. Certains d'entre eux y voyaient plus un superjuge spécialisé dans les questions environnementales. Avec d'autres membres, nous étions plus sur l'idée d'une autorité complètement indépendante. Je ne suis pas partie sur la création d'un nouveau juge car je suis très attachée à l'équilibre des pouvoirs tels qu'ils existent aujourd'hui en France. On s'est attelé à réfléchir à un autre modèle. C'est pourquoi six mois de mission n'ont pas été de trop pour penser une redéfinition de notre action politique et proposer (1) une autorité totalement indépendante des pouvoirs politiques et économiques en matière de défense de l'environnement.
AE : Quelles seront les garanties d'indépendance de cette autorité ?
CM : D'abord son statut : une autorité administrative indépendante. Ensuite, son mode de nomination : c'est un mandat unique de six ans qui va donc traverser deux quinquennats. Le Défenseur de l'environnement ne pourra avoir aucun mandat politique ni aucune activité professionnelle, de la même façon que le Défenseur des droits. Le statut ne garantit pas pour autant totalement l'indépendance. Nos travaux ont montré que la collégialité était indispensable. Si on devait le comparer à une structure existante en termes d'organisation, on pourrait regarder le Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui a une véritable collégialité. On peut envisager de dix à vingt personnalités qui puissent organiser cette collégialité. L'idée, c'est de proposer un dispositif au Gouvernement mais c'est lui qui tranchera. Cela pourra aussi évoluer dans le temps.
AE : Qui nommera les membres de cette autorité ?
CM : Le président de la République nommera le Défenseur de l'environnement, sachant que la date de nomination sera à mi-mandat présidentiel. En ce qui concerne les autres membres, je propose une fusion de certaines autorités existantes, comme la Commission nationale du débat public (CNDP), le Médiateur de l'eau, le Médiateur de l'énergie et le Haut Conseil pour le climat (HCC). Chacune des structures fusionnées sera représentée de manière proportionnelle.
AE : Quelles organisation administrative préconisez-vous pour cette nouvelle entité ?
CM : Nous allons mutualiser les différentes instances car elles ont toutes des statuts différents. Et on va aussi regrouper le personnel. C'est ce qui est intéressant car il y a vraiment de grosses différences en termes de dotations. Le Médiateur de l'énergie, par exemple, a 46 équivalents temps plein (ETP), contrairement au Haut Conseil pour le climat qui a très peu de moyens humains et pourtant un carnet de commandes assez important. Cette mutualisation permettra aussi d'apporter plus de réponses sur certains sujets environnementaux.
AE : Cette réforme pourrait-elle impacter d'autres instances comme l'Autorité environnementale ?
CM : Ça a été une vraie question. À un moment donné, le Défenseur de l'environnement va avoir forcément besoin des compétences de l'Autorité environnementale (Ae). Pour autant, si on la fusionne, cela veut dire que, derrière, on va récupérer une partie de l'État à travers le ministère de la Transition écologique. Car, derrière l'Ae, il y a aussi le CGEDD. Du coup, en termes d'image, on perdrait en indépendance. Et on enlèverait au ministère une fonction que l'on connaît peu au sein de l'Ae, celle de l'inspection interne des services. On propose en revanche que le Défenseur de l'environnement puisse saisir les compétences de l'Ae sur les grands rapports. Je pense toutefois que d'ici quelques années l'Ae pourra rejoindre le Défenseur de l'environnement, mais chaque chose en son temps.
AE : Quelle sera la mission du Défenseur de l'environnement ?
CM : Un citoyen, un collectif, une entreprise pourra saisir facilement une seule autorité en charge des questions environnementales en France. On s'est rendu compte que le Défenseur des droits arrivait à résoudre plus de 80 % des saisines par de la médiation. On s'est dit qu'il était fondamental de construire à l'échelle des territoires la médiation de toutes les parties pour sortir de la dualité liberté d'entreprendre/protection environnementale. Tout ce process de médiation doit avoir lieu avant l'enquête publique pour éviter les contentieux, car l'objet est vraiment là. Et, pour ça, il faut pouvoir s'appuyer sur un réseau territorial qui sera constitué de délégués à l'échelle du département. On s'appuiera sur deux réseaux existants : les garants de la Commission nationale du débat public, complétés par les commissaires-enquêteurs.
AE : Est-ce que cela implique une réforme des enquêtes publiques ?
CM : Non, on ne change pas le process. Il continuera à y avoir enquête publique lorsqu'il doit y avoir enquête publique. Sauf que, sur de gros projets, si le Défenseur est saisi ou s'autosaisit, l'enquête publique se déroulera de façon plus réussie et évitera d'aller au contentieux. Car ce n'est pas parce qu'il y a enquête publique qu'il n'y a pas de recours derrière. On a constaté aussi que peu de monde participe aux enquêtes publiques. Et c'est assez dramatique.
AE : Les justiciables ne seront-ils pas privés de recours judiciaire avec une telle réforme ?
CM : Non, ça ne les privera pas. Dans le cas où le point d'équilibre ne serait pas trouvé par la médiation, le Défenseur de l'environnement pourrait se constituer partie civile.
AE : Votre proposition est-elle en phase avec le droit européen ?
CM : L'Union européenne demande de plus en plus aux pays membres d'avoir des institutions indépendantes. C'est le cas avec le Médiateur de l'eau. Par la création d'une autorité indépendante du ministère de l'Écologie, on a une action plus forte et plus reconnue et on dépolitise les questions environnementales. J'ai eu la chance, en plus de l'appui du CGDD et du CGEDD, d'être accompagnée par un maître des requêtes du Conseil d'État qui a cadré chacune des propositions pour qu'elle soit non seulement conforme à la Constitution française mais aussi au droit de l'UE. On serait les pionniers à l'échelle européenne en ayant une telle autorité indépendante avec un périmètre aussi large.
AE : De quelle manière peut-on créer cette autorité ?
CM : Deux possibilités : soit un projet de loi organique, soit une révision constitutionnelle. C'est un trop gros sujet pour qu'il puisse être inscrit à l'ordre du jour avant la fin du quinquennat. Il faut en outre continuer à le travailler pour en faire une proposition pour l'élection présidentielle. Et le mettre en place dès le début du prochain quinquennat si le président de la République est réélu.